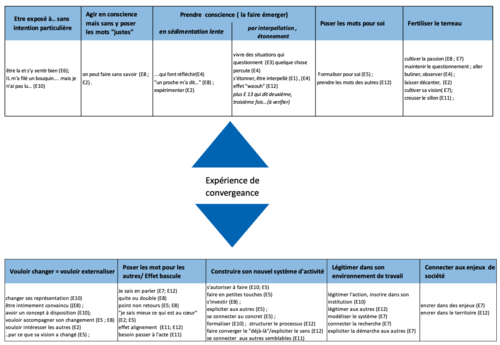Suite des articles autour de la coopération
Coopérations
Le Rhetoric Retreat 2024 qui a eu lieu du 12 au 14 janvier 2024 a rassemblé 35 étudiants sélectionnés de presque toutes les écoles de l'Institut Mines-Télécom, ainsi que 7 professeurs d'anglais lors d'un week-end convivial autour du débat en anglais. C'est dans le cadre bucolique La Ferté-Saint-Cyr en Sologne que des étudiants de tous niveaux ont eu l'opportunité de progresser en anglais grâce à une initiation aux techniques de débat de type parlementaire. Ce style de débat, né en Angleterre au 19ème siècle et largement répandu dans le monde d'aujourd'hui, place le gouvernement contre son opposition dans une joute oratoire autour d'une motion. La prise de parole alterne entre les deux équipes et chaque membre de chaque équipe doit parler, exposant des arguments soit pour (s'il est membre du gouvernement) soit contre (s'il fait partie de l'opposition).
Les 7 écoles impliquées dans cette activité pédagogique étaient : IMT Atlantique, IMT Mines Albi, IMT Mines d'Alès, IMT Nord Europe, Institut Mines-Télécom Business School, Mines Saint-Etienne (Campus Provence), et Télécom Paris. Les étudiants et étudiantes venaient, quant à eux, des quatre coins de la France et du monde, incarnant la diversité que l'Institut Mines-Télécom nourrit par son vaste ancrage territorial. Le format des petits ateliers et la mise en place immédiate des techniques apprises à travers des « mini-débats » ont contribué à renforcer la confiance des elèves participants en leur capacité à prendre la parole en anglais et à perfectionner leurs techniques oratoires pour les plus avancés. Les motions proposées au débat alternaient entre des sujets sérieux et comiques : "Cette Assemblée estime que l'éducation se fait en dehors des cours", "Cette Assemblée souhaite interdire les hauts talons", et bien d'autres.
Outre le temps consacré aux débats, les élèves ont participé aux activités qui ont encouragé une dynamique positive du groupe tel qu'une balade d'écoute empathique, des repas pris ensemble devant un grand feu de bois au foyer, et une soirée « danse écossaise » ou même les plus réticents ont été emporté par ces danses traditionnelles, folkloriques. Les dortoirs, anciens écuries transformées en gîte, ont imprégné l'air des doux rêves faisant ce week-end à la fois reposant et dynamique.
Réactions des étudiants (en anglais)
Au final, le Rhetoric Retreat a remporté un franc succès. La totalité des étudiants ayant répondu au formulaire de satisfaction souhaite qu'il soit proposé à nouveau. Voici le verbatim d'un participant « This week-end simply brought me joy. » (Ce week-end m'a tout simplement apporté de la joie.) Son succès se trouvait sans doute dans sa diversité : plusieurs écoles, une variété d'approches pédagogiques, différents niveaux d'anglais, des élèves de tous horizons. Et après avoir passé presque 3 jours ensemble, à construire des arguments, à tenter de convaincre le public d'en face et à employer les 3 piliers des techniques de persuasion - ethos, logos, et pathos - ; il était évident que pour bien s'entendre, une bonne communication était la clef !

Durant la crise du Covid la direction innovation publique du CNFPT (Centre National de la Formation Publique Territoriale) a utilisé un espace collaboratif ouvert : Riposte Créative Territoriale pour poursuivre ses activités durant le confinement. Pendant deux ans, quelques dizaines de personnes ont ainsi développé un espace dans un esprit de communs, en participation ouverte, où tout ce qui était produit était public et rendu réutilisable par une licence Creative Commons. Une étude menée à travers 13 interviews a permis d'expliciter ce que recouvrait pour les participants actifs à Riposte Créative Territoriale cette pratique des communs. Communiqués lors d'un colloque ESREA à Milan (Sanojca Briand, 2022), les résultats de cette étude proposent une grille en dix niveaux pour décrire l'appropriation des communs. Cet article présente cette grille, pour la rendre accessible et réutilisable lorsqu'il s'agit d'évaluer un niveau d'engagement dans la participation aux communs. L'écrit s'appuie sur le texte de la communication parue dans les actes du colloque "New seeds for a world to come : policies, practices and lives in adult education and learning"
Cette grille est maintenant utilisée dans une nouvelle étude auprès d'une communauté d'agents du service public "Utilo", autour de la facilitation. le projet Utilo Tilab laboratoire d'innovation publique d'intérêt général commun. Cette nouvelle étude interroge "en quoi la pratique des communs peux être facteur d'émancipation au travail".
Résultat d'une étude auprès des acteurs de Riposte Créative Territoriale durant le confinement et la crise du Covid
La notion de communs est définie par trois caractéristiques interdépendantes : «
(1) une ressource en accès partagé ;
(2) un système de droits et d'obligations (un faisceau de droits) qui précise les modalités de l'accès et du partage des bénéfices associés entre les ayants-droit et enfin
(3) l'existence d'une structure de gouvernance qui veille au respect des droits et à la garantie de la reproduction à long terme de la ressource » (Coriat, 2017, p. 267). [1]
Michel Briand : Pourrais tu te présenter en quelques mots ?

ES : Je m'appelle Elzbieta Sanojca, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 2. Je m'intéresse à la formation des adultes et en particulier à la manière dont les adultes apprennent. Cela concerne non seulement les formes formelles d'apprentissage (formation continue par exemple), mais aussi et surtout les formes non formelles voire informelles d'apprentissage, par l'activité de travail par exemple, l'engagement dans des collectifs professionnel ou citoyen etc...
Dans les différents contextes où l'apprentissage peut se produire, je m'intéresse en particulier à la dynamique collaborative qui conduit à la co-construction des savoirs. Mes travaux actuels s'inscrivent en continuité de ma recherche doctorale (Sanojca, 2018) qui portait sur l'analyse des compétences collaboratives et leur développement en formation des adultes. [2]
MB : Peux-tu présenter l'étude réalisée autour de Riposte Créative Territoriale Créative et de la pratique des communs à cette occasion ?
ES : C'est une étude qui porte sur le collectif qui, au sein de la direction Innovation du CNFPT (Centre National de la Formation Publique Territoriale), a ouvert un espace collaboratif nommé Riposte Créative Territoriale, en réponse à la crise du Covid-19 [3].
Si les personnes impliquées dans cette dynamique ont été auparavant sensibilisées aux pratiques de l'innovation publique, cette nouvelle expérience de Riposte a fait apparaître un éléments particulièrement intéressant : ces collectifs apprenants ad hoc ont tenu à affirmer une valeur particulière attribuée à à la dynamique d'apprentissage et aux ressources produites collectivement (les connaissances). Le terme de « communs » en référence aux travaux d'Elionor Ostrom a été choisi par les acteurs des Ripostes pour designer cette valeur.
C'est par le choix de ce terme qu'apparaît le lien avec mes précédents travaux : je rappelle rapidement que " avoir le souci des communs " est le troisième pivot [4] des compétences collaboratives que j'ai identifié dans ma thèse [5].
La notion de communs est importante dans la dynamique de collaboration. Avoir ce souci des communs peut renforcer la durabilité d'efforts collectifs pour travailler sur le projet. Cela se produit, lorsque les collectifs se questionnent sur la nature de ce qui est collectivement produit et en plus lui confèrent la valeur de communs par exemple par l'attribution d'une licence de partage telle les « Creative Commons ».
Ce qui m'a paru intéressant de questionner dans le cas de Riposte est de savoir :
en quoi cette forme de valorisation des productions issues des apprentissages en communs (les connaissances) fait naître de nouvelles pistes pour penser la formation des adultes aujourd'hui ?
MB : Quelles étaient les personnes concernées par ces entretiens ?
ES : Riposte Créative Territoriale (RCT) est un espace collaboratif créé de manière spontanée en réponse à la crise du COVID et concerne des acteurs de l'innovation territoriale proches de la direction innovation du CNFPT.
Durant les 18 mois de fonctionnement que cette enquête prend en compte, trois phases se sont succédées :
- une réaction au choc du 1er confinement avec un fonctionnement en groupes de travail (mars-juin 2020) ;
- un temps de pérennisation, avec l'élargissement à des agents de collectivités territoriales sur des problématiques identifiées par les acteurs RCT (ex : « nouveau rôle du manager public » ou « implanter le collaboratif dans nos structures ») (automne-hiver 2020) ;
- un temps de ré-institutionnalisation avec la mise en place de modalités de formation en « cercles apprenants » (au printemps 2021).
Les personnes qui ont participé à cette dynamique du dispositif « Riposte » sont des personnes qui pour beaucoup se connaissaient déjà avant puisque qu'elles ont participé aux activités de cette direction, notamment aux Universités de l'innovation publique qui existaient depuis trois à quatre ans avant la crise. Pour cette étude nous avons sélectionné les acteurs les plus impliqués dans la dynamique de « Riposte », soit treize personnes interviewées par entretien compréhensif [6].
MB Qu'est- ce que les entretiens t'ont permis de comprendre ?
ES : Pour répondre à cette question, il faut préciser le cadrage théorique auquel l'analyse des données se réfère. Il s'agit de la théorie de l'activité d'Yrjö Engeström (Engeström, 2010) qui soutient, entre autres, que la transformation de l'activité s'appuie sur un nouveau concept qui se forme dans un mouvement allant de l'abstrait vers le concret. Sous cet angle il s'agit de comprendre comment le concept de communs influence les changements de pratiques des professionnels dans leur contexte de travail, une fois l'expérience d'apprentissage collectif passée.
Au final, les entretiens m'ont permis de dégager plusieurs étapes de maturité dans la prise en compte du concept de communs dans la conscience ou/et dans les pratiques des personnes interviewées. C'est le résultat principal de cette étude : établir un cheminement des conscientisations du concept de communs qui s'effectue dans un double mouvement :
- interne, lié à une une prise de conscience progressive du sens du concept ;
- externe : un moment où les personnes commencent à agir de manière visible, au nom du concept particulier, ici, donc, les communs.
La grille de compréhension
La figure qui suit catégorise les moments signifiants de la formalisation du concept de « communs » à partir de la description des activités professionnelles réalisées par les enquêtés, avant, pendant ou après l'expérience de RCT. Chaque catégorie s'accompagne des exemples de verbes d'actions estimés les plus explicites pour comprendre le sens attribué à la catégorie choisie.
– En premier « Etre exposé à sans intention particulière » :
Les personnes sont prises dans un mouvement sans une intention personnelle clairement formulée ; elles sont en quelque sort exposées aux usages d'un concept qui ne fait pas partie de leur culture. L'expérience vécue est positive « je me sentais bien dans ce paysage des personnes ou dans cet environnement des personnes qui parlaient des communs » (comme le disent les interviewés) ; c'est probablement une condition pour que le souhait d'approfondissement apparaisse.
– En second « Agir en conscience mais sans poser les mots justes » :
C'est un autre cas de figure : on peut faire des communs sans le savoir. C'est d'ailleurs la situation de la plupart des « commoneurs », tels la grande majorité des 20 000 acteurs des jardins partagés en Bretagne qui pratiquent les communs en actes [7]. Dans le cas de RCT, quelques dizaines de personnes ont contribué occasionnellement à la dynamique sans pour autant avoir conscience de participer à un commun.
au départ du dispositif RCT, pour beaucoup de participants la notion de communs a été introduite par les deux animateurs du projet. « le terme de communs est d'emblée affiché pour rendre compte de la manière de fonctionner du collectif : “Ces communautés de pratiques ouvertes sont animées dans une logique de communs comme une modalité de fonctionnement de communs attribuée aux productions collectives. Cela se traduit par les règles de fonctionnement (« accords de groupe ») proposées et discutées par les acteurs de la communauté : (1) toute personne peut contribuer ; (2) tous les échanges, notes de réunions, sont publiés et restent accessibles y compris aux non participants ; (3) à ces productions sont attribuées une licence qui les protège comme communs (Creative Commons by sa).
Toutefois, ce terme de communs est consenti plus qu'il n'est choisi au moment de la création de RCT. Il fait consensus puisque sa compréhension est chargée d'ambiguïtés surtout pour les acteurs du service public qui l'associent avec la notion d'intérêt général et parfois même l'utilisent en synonyme de « mise en commun ».
– Les étapes suivantes, sont elles liées à une prise de conscience progressive « Prendre conscience la faire émerger » :
- en sédimentation lente :
Vivre des situations qui interpellent. Cela se produit dans un mouvement de l'inconscient vers l'intentionnel, sans pour autant que le croisement avec un concept ait eu lieu. En participant à l'espace de RCT où tout ce qui est produit est mis en ligne, donc partagé avec les autres, chacun peut contribuer et publier directement sans passer par une validation de sa hiérarchie. Beaucoup de personnes sont interpellées par ce mode de fonctionnement qui n'est pas habituel dans leur organisation.
- par interpellation, étonnement
Cela se passe par la découverte : « tiens, quelqu'un parle de communs et ça nous fascine. » Elle peut s'accompagner de l'effet « wouahou », un enchantement qui surgit lorsqu'un événement fort se produit imposant sinon une remise en cause, toit au moins un arrêt réflexif et un examen d'un fonctionnement habituel « oui, ça me parle ; c'est quelque chose auquel j'aimerais bien m'intéresser ».
A partir de ce moment du processus, l'attention d'une personne s'éveille et la formation d'un concept devient plus intentionnelle, car dorénavant dotée d'un nom.
– L'étape plus avancée de l'appropriation d'un concept (ici : les communs) serait « poser les mots pour soi » :
« Formaliser pour soi », « prendre les mots des autres » sont des expressions qui témoignent cette prise de conscience. Si, nous l'avons dit, au début de RCT seuls les concepteurs de l'espace faisaient clairement référence au terme de communs, les entretiens montrent qu'avec l'expérience de RCT, la compréhension de ce concept s'affine et s'harmonise. Elle rentre dans le vocabulaire des participants : neuf interviewés sur treize emploient ce mot pour définir RCT.
– Puis « fertiliser le terreau » :
Vient ensuite cette étape d'enrichissement ou comme l'exprime certains de « cultiver le terreau » de ce nouveau concept. Cela peut prendre des formes très diverses, par exemple lire des textes sur les communs, échanger avec des personnes actrices des communs, etc...
Les verbes associés à ses formes d'activités sont : « cultiver la passion », « maintenir le questionnement », « aller butiner », « observer ». Il reste à noter que cette phase de fertilisation du terrain peut être extrêmement longue.

– « Vouloir changer », « vouloir externaliser » :
C'est un moment décisif pour passer à l'action. Il est comparable à ce que l'on désigne par la conversion des opportunités vers les choix effectifs (Sen 1984/2008). Les expressions collectés dans nos données qui illustrent cette phase sont : « changer ses représentations, « être intimement convaincu », « avoir un concept à disposition », « vouloir accompagner son changement », « vouloir intéresser les autres parce ce que sa vision a changé ». A partir de ce moment, et si des conditions externes convergent, un passage à l'action peut avoir lieu.
– « Effet bascule » :
C'est la prise de conscience mise en actes qui fait bascule. J'appelle ça « un point bascule » puisqu'il existe clairement un « avant » et un « après » dans la manière d'agir des acteurs concernés. Cela s'exprime par une phrase telle que : « Non, là, je ne peux plus faire comme avant. ».
Cet effet de bascule, dans le cas des Ripostes, était assez facile à identifier, puisque qu'il s'est produit dans un moment de crise entendu au sens large comme étant une période difficile, traversée par un individu, par un groupe et qui entraîne une recomposition et transformation du système qui n'est plus opérant. La crise peut donc faire basculer l'intention vers l'action mais la forme de l'action choisie dépend d mate la maturité du concept qui oriente la structuration d'un nouveau système de l'activité.
– « Construire son nouveau système d'activité » :
A ce stade, la personne commence à justifier l'envie de faire autrement son métier : « depuis toujours, j'ai considéré qu'il faut que je fasse mon métier de telle manière ; là, je ne peux pas faire autrement. » Cette volonté de changement - s'exprime de différentes manières : s'investir, expliciter aux autres, faire converger le « déjà-là ».
Le changement implique la construction d'un nouveau système d'activité. Dans les données collectées, les expressions sont nombreuses pour décrire ce changement : « se donner un espace d'autorisation », « faire des petites touches », « se connecter au concret » ou « structurer le nouveau processus », « formaliser », « expliciter le sens »...
C'est une première étape d'ancrage dans la réalité. Dans le cas de RCT, le nouveau systéme d'apprentissage que les personnes ont commencé à concevoir correspond à un nouveau dispositif de formation, les cercles d'apprentissage [8].
– « Légitimer dans son environnement de travail » :
C'est une forme plus implantée de la transformation. Elle se traduit par les verbes d'action tels que : « légitimer l'action », « se connecter aux autres semblables », « modéliser, connecter la recherche », « expliciter la démarche aux autres ». Non seulement on produit des transformations par petites touches de ses activités, mais on commence à diffuser ces comportements dans la culture de sa structure. Dans cette étape, la constitution d'alliances est nécessaire pour établir un rapport de force favorable et pour garantir une durabilité du système d'activité naissant.
– Et la dernière étape, « connecter aux enjeux de société »
est la plus mature de l'appropriation d'un concept de communs que nous avons identifié dans les données collectées (présente seulement pour une personne interviewée). A ce niveau, il s'agit d'un élargissement du périmètre d'actions possibles : le désir de transformation s'ancre dans l'environnement de vie, au-delà de l'espace d''activité professionnelle. L'engagement dans cette logique de communs s'exprime en connexion aux enjeux de société et s'illustre par la construction d'un réseau de partenaires et associatif, l'implication dans une dynamique de territoire.
MB Merci de cette présentation de la grille d'appropriation du concept de communs. Quelle suite pour ce champ d'études de la transformation professionnelle et personnelle ?
ES : Cette étude a mis en exergue le processus de transformation à partir d'une appropriation d'un concept de communs : nécessairement long et en partie invisible. La linéarité de l'échelle est indicative car, en réalité la progression dépend de nombreux facteurs externes ou internes (les aléas de la vie quotidienne ou bien les conditions du contexte professionnel plus ou moins favorables, ou encore les dispositions des personnes à percevoir et intégrer ce qui s'offre à elles comme une ressource utile).
C'est un outil d'appréciation d'un cheminement d'une transformation des pratiques à partir d'un concept de communs, évalué sur la base de ce qui est, ou pas « déjà-là » dans la conscience des personnes.
Pour la suite nous voudrions approfondir la compréhension des transformations des pratiques dans des environnements professionnels qui découlent d'une pratique de productions de communs. Ce faisant, nous voudrions vérifier la thèse de Pharo (2022), qui considère que le désir de rétablir une part de communs dans la vie sociale équivaut à une forme renouvelée d'émancipation. Selon lui, agir au nom des communs permet de créer des espaces intermédiaires d'équilibre ; cela en contrepoids des logiques marchandes et de la recherche de performance.
Il pourrait être intéressant de questionner la robustesse des transformations prenant appui sur les communs : en quoi les communs produisent de manière effective des changements dans les organisations ? Mais aussi, quelle est la force émancipatrice des communs au sein de collectifs de travail ? C'est d'ailleurs l'axe de travaux conduits actuellement avec un spécialiste du sujet d'émancipation Jérome Eneau.
Cette nouvelle étude s'effectue à partir du projet Utilo [9], décrite par des personnes qui y sont engagées au sein d'une communauté d'acteurs de l'innovation publique territoriale. Ces acteurs se rencontrent dans un espace de tiers-lieu de l'innovation territoriale le « Tilab » qui est un laboratoire d'innovation publique porté par la Région et les services de l'état en région Bretagne. Nous souhaitons décrire ce processus d'émancipation qui prend appui sur la participation aux communs : de quoi on se libère ? pour aller vers où ?
Bibliographie
Coriat, B. (2017). Communs, l'approche économique. Dans, M. Cornue, F. Orsi, J. Rochfeld (dir.) Dictionnaire des biens communs (p. 266- 269). PUF
Engeström, Y. (2010). Activity Theory And Learning At Work. Dans M. Malloch, L. Cairns, K. Evans, & B. O'Connor, The SAGE Handbook of Workplace Learning (p. 86-104). Sage publications.
Pharo, P. (2020). Éloge des communs. Presses Universitaires de France.
Sanojca, E. (2018). Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation. Rennes, Université Rennes 2. (en ligne sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01709910)
Sanojca, E. Briand, M. (2022). The ‘commons' as a new value in adult learning. Proceedings of the 10th ESREA Triennial European Research Conference. University of Milano Bicocca, September 29 – October 2 2022, Milano, Italy (sous presse).
Sen , A (1984/2008) Capability and Well-Being. Dans D. M. Hausman (ed.) Phe philosophy of economics : an anthology (pp. 270-293). Cambridge University Press
[1] les phrases mises en citation sont extraites de la traduction de l'article (Sanojca, E. Briand, M. , 2022)
[2] Voir à ce sujet l'article :
"Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride." qui présente quelques résultats de la thèse qui "cherche à identifier les compétences à développer pour travailler plus facilement avec les autres avec un éclairage sur ces capacités d'agir, appelées par convenance « compétences collaboratives », ainsi que les modes opératoires de leur développement en formation". (Sanojca 2018)
[3] En réponse à la crise du Covid-19, le labo du CNFPT a lancé la "Riposte créative territoriale" dès mars 2020, à l'initiative de membres de la communauté de l'innovation publique territoriale (retrouvez l'appel initial). L'objectif ? Co-construire, avec les collectivités territoriales, les réponses formatives innovantes pour faire face à ces défis complètement inédits, en mobilisant l'intelligence collective. Comment développer des modes d'apprentissage dans l'urgence, pour des solutions créatrices de valeur sociale pour le service public territorial et la démocratie locale ? Notre intention fait écho à l'alerte de Bruno Latour : « Si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, ce serait gâcher une crise. » extrait de la présentation de la génèse en ligne.
[4] « L'état d'esprit collaboratif », « faire avec » et « avoir le souci des communs » : trois pivots pour coopérer, dans Innovation pédagogique et transition, mars 2018.
[5] Sanojca, E. (2018). Les compétences collaboratives et leur développement en formation d'adultes. Le cas d'une formation hybride. Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation. Rennes, Université Rennes 2.
(en ligne sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01709910 ).
Cette étude s'inscrit dans dans l'intérêt que je porte aux processus de coopération que je divise en trois temps :
- le premier, préalable à la coopération, concerne les caractéristiques individuelles des personnes ;
- le second sur le processus lui-même : comment les personnes font pour travailler ensemble ;
- et enfin comment s'élabore le produit collectif et quelle est la relation à ce produit collectivement réalisé.
[6] Dans une visée compréhensive, l'enquête relève d'une démarche qualitative et s'appuie sur deux sources de données :
- les treize entretiens compréhensifs (Kaufmann, 2011) où la sélection des interviewés prenait en compte le critère d'implication dans RCT (les plus actifs). Cela représente 7 femmes et 6 hommes, majoritairement cadres de la fonction publique (85 %), acteurs du réseau de l'innovation publique territoriale, avec une expérience de 2 à 3 ans minimum (77%).
- dans une moindre mesure, les données textuelles à partir des productions des groupes impliqués dans la dynamique de RCT.
[7] avec pour chaque jardin une gouvernance particulière adaptée au contexte de leur jardin voir à ce sujet Vert le jardin.
[8] les cercles proposés viseront à s'ouvrir au paradigme de l'apprenance en multipliant les espaces ouverts, collectifs, réflexifs, expérientiels, fondés sur l'autonomie des apprenants pour favoriser leurs apprentissages à l'intérieur et à l'extérieur de leurs espaces dédiés.
Ces cercles viseront donc à répondre aux attentes des participants en proposant une opportunité de transformation à partir de leur expérience professionnelle. Ils seront donc des espaces apprenants mais aussi capacitants (Cf. Monique Castillo, Christian Batal et Solveig Oudet) dans la mesure où ils contribueront au développent du pouvoir d'agir des participants.
Extrait de la page de présentation des cercles sur RCT
[9] Comment animer une communauté d'entraide et susciter l'intelligence collective pour concevoir ou faire avancer un projet ? Quelles sont les méthodes et pratiques sur lesquelles on peut compter pour animer un atelier coopératif, mener une démarche participative dans son ensemble, ou encore aider à la mise en place d'un projet de co-conception ?
Voici les questions que se sont posés les pionniers de la communauté UTILO. Ce groupe de 25 agents publics venant de 14 administrations et collectivités différentes ont alors créé collectivement le guide UTILO.
extrait de la page de présentation du projet
Le dispositif Riposte Créative Pédagogique a été créé pour répondre à un besoin d'agir en coopération ouverte entre acteurs de l'enseignement supérieur face à la crise du COVID. La création du groupe “Hybridation des formations en coopération ouverte” marque une étape importante de transformation de ce dispositif et démontre l'amplification de la coopération ouverte rendue possible par le numérique. Le mode de fonctionnement agile a rendu possible un travail collectif important pour mieux partager des éléments de réponse aux enjeux identifiés.
1. Introduction
Lors du premier confinement, en mars 2020, des espaces ouverts de coopération ont été créés “pour apprendre ensemble de la crise, favoriser les solidarités, mutualiser les initiatives et préparer l'après” dans une logique de communs. Le premier espace Riposte Créative Territoriale a été initié par le CNFPT et a rapidement donné lieu à des initiatives similaires, dont le tiers lieu Riposte Créative Pédagogique qui a recensé et partagé initiatives et ressources ouvertes dans l'enseignement supérieur durant le confinement. Des collectes de récits et des idées pour l'”après la crise” recueillis à partir d'un questionnaire issu des travaux de Bruno Latour (Latour, 2020) ont complété ce dispositif. À l'instar du magazine contributif Innovation Pédagogique, il s'inscrit dans une dynamique de valorisation et de partage des savoirs, de manière transverse aux institutions et aux collectifs professionnels.
L'expérience du premier confinement et la perspective de la crise à long terme ont fait émergé plusieurs constats : (i) la nécessité d'aller au-delà du simple recensement des initiatives, (ii) le besoin d'initier un travail collectif pour mieux aborder les questions d'hybridation en partageant les réflexions (iii) l'intérêt de diffuser les bonnes pratiques autour du partage des ressources ouvertes, (iv) le besoin d'engager un développement professionnel collaboratif. En partant du principe que l'entraide est la modalité la plus efficace pour agir en situation de crise, un groupe ouvert à tous les acteurs de l'enseignement supérieur a été créé en juin 2020 (Gilliot, 2020). Rapidement, il a dépassé la centaine de membres issus de l'ensemble de la francophonie, en regroupant tous les profils de l'enseignement supérieur (enseignants de toutes disciplines, formateurs, chercheurs, ingénieurs et conseillers pédagogiques, documentalistes, informaticiens, cadres ...). La création du groupe “Hybridation des formations en coopération ouverte” marque la transformation du dispositif Riposte Créative Pédagogique et démontre l'amplification de la coopération ouverte rendue possible par le numérique.
Dans la suite de cette contribution, nous explicitons le besoin d'une riposte à la crise dans l'enseignement supérieur pour introduire la coopération ouverte comme mode efficient pour répondre à ce besoin. Nous présentons en quoi le numérique facilite ce mode et en quoi le travail en archipel permet de renforcer cette dynamique de coopération. Nous nous intéressons ensuite au groupe "Hybridation des formations en coopération ouverte” en tant que dispositif exemplaire.
2. Agir en temps de crise : la coopération ouverte
2.1. Après le premier déconfinement : la nécessité d'une riposte
La crise sanitaire et le premier confinement ont soudainement bouleversé les conditions d'enseignement, confrontant les établissements à la nécessité d'organiser dans l'urgence des dispositifs de formation hybride à distance. Un bouleversement des pratiques qui a mis les institutions en état de choc, concentrées sur les évolutions à marche forcée vers l'hybridation. Même si beaucoup d'établissements avaient engagé un développement de plateformes numériques avec des formes d'hybridation, peu avaient engagé une hybridation de masse (souvent réservé à un certain public, avec des enseignants technophiles ou sur un temps défini : maladie, empêchement…). En l'espace de quelques jours, il a fallu développer la massification de la formation à distance pour tous les étudiants et tous les enseignants. Après un premier temps de "débordement", de nombreux personnels, enseignants ou non, ont souhaité se rassembler pour partager des ressources et mutualiser des dispositifs. Cette collaboration reflète déjà un premier niveau de (ré)action rapide en temps de crise.
Le besoin est apparu d'avoir un lieu d'échanges inter-établissement et même plus largement en dehors des visions “établissement”. Riposte Creative Pédagogique y a participé à côté de la multiplication des articles autour de l'hybridation et de la riposte pédagogique (le magazine Innovation pédagogique a relayé plus de 200 articles sur le sujet en un an dans le seul noyau des sites aux contenus réutilisables). La diversité des acteurs de la Riposte en fait un commun riche, qui permet de dépasser la rivalité et le cloisonnement entre établissements. C'est un début de communauté de pratique, (Wenger, 1998) ouverte qui offre un environnement sans pression professionnelle (pas d'enjeux entre les acteurs, pas de stratégie concurrentielle d'établissement) qui favorise l'échange de pratiques entre métiers complémentaires et la réutilisation de ressources.
2.2. Un mode d'action efficient : la coopération ouverte
La coopération ouverte (Sanojca et Briand, 2018 ; Briand, 2019) outillée par le numérique permet de réagir rapidement là où des structures en fonctionnement plus vertical restent concentrées sur leur fonctionnement interne avec une acceptabilité qui découle de la situation de crise vécue. L'expérience de Riposte Creative Territoriale initiée avec la direction innovation du CNFPT a montré l'intérêt d'un partage ouvert pour les collectivités confrontées à une situation de crise. Des pratiques innovantes comme l'écriture ouverte à tous (sur un wiki sans modération à priori), dans une transparence du fonctionnement du collectif (toutes les réunions font l'objet d'une prise de notes collaborative sur un pad retranscrit ensuite en page du wiki) et en partage des contenus (interviews, base de données d'initiatives et de ressources) par une licence Creative Commons ont été adoptées par cette communauté de l'innovation territoriale. Ce changement de posture qui aurait demandé des années dans une situation ordinaire a été adopté en quelques semaines dans cette situation de crise. Et dans le cas du CNFPT il a fait émerger une pratique de formation en cercles apprenants innovante par rapport aux modes de fonctionnement ordinaires très structurés et descendants de cet organisme qui forme un million d'agents des collectivités chaque année.
Riposte Créative Pédagogique a permis quant à lui d'expérimenter une coopération ouverte en agrégeant des initiatives individuelles, en favorisant des échanges. Créé par quelques personnes bénévoles en marge du temps de travail professionnel, Riposte Créative Pédagogique a un impact et une portée modeste. Toutefois le succès de la quinzaine de webinaires organisés sans autre moyen que le site et la diffusion sur les réseaux sociaux rend compte de l'émergence de pratiques rendues possibles par la coopération ouverte en attention aux propositions des uns et des autres. Cette ouverture du champ des possibles se retrouve un an plus tard dans l'émergence de cercles apprenants et de nouveaux champs de coopération comme les Ressources Éducatives Libres ou la prise en compte de la Transition écologique dans l'enseignement supérieur francophone.
2.3. Le numérique comme facilitateur de la coopération
La démarche des Riposte Créative est construite autour d'un outil libre (yeswiki) facile à mettre en œuvre et à utiliser. Les différents projets en ”Riposte” ont tous démarré par une séquence interactive, où en l'espace de deux heures le site est mis en place, les premières bases de données sont installées. Modifier en direct la barre du menu, ajouter une rubrique, éditer la page d'accueil d'un simple double clic sont de petites expériences irréversibles de coopération qui marquent le groupe. L'outil est ainsi au service du groupe qui peut l'adapter, produire immédiatement des contenus, les cartographier sans être dépendant d'un plan de financement ou d'un temps de développement logiciel. Riposte créative pédagogique s'inscrit ainsi dans la notion d'outil convivial d'Ivan Illich (1973), un outil qui augmente l'efficience du groupe sans impacter l'autonomie individuelle, sans générer ni maître ni esclave et augmente le pouvoir d'agir.
Les Riposte nécessitent néanmoins une animation, comme tout projet coopératif. Elles reposent sur une animation qui est ici duale. A côté de la fonction d'animateur, qui va caler les règles, définir les objectifs, aider le groupe à avancer, à être productif, à grandir en maturité s'ajoute une animation techno-pédagogique autour de l'appropriation de l'outil (Merlet et al., 2021)
2.4. Le travail en archipel pour relier les initiatives
Le fonctionnement en archipel est une autre originalité des projets Riposte Creative. Dans l'esprit de l'idée développée par Édouard Glissant, poète et philosophe proche d'Aimé Césaire, et popularisée en France par l'Archipel “Osons les jours heureux" (Les Jours Heureux, 2017). Les Ripostes Créatives favorisent une interconnexion des initiatives (les identités relations qui relient les identités racines des îlots). Ainsi les différents sites Ripostes sont mentionnés dans le bas de page d'accueil de chacun. Facilité par l'usage d'une base logicielle commune (yeswiki), la structure de la base de données de l'un peut être aspirée par l'autre et rendue opérationnelle en quelques minutes.
Cette idée d'archipel des Ripostes a été développée dans Riposte Creative Territoriale par Patrick Viveret, elle est aussi reprise dans des dynamiques comme celle du collectif des “Chatons” (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) initié par Framasoft, le réseau des formations à la coopération Animacoop, le réseau émergeant des lowtech ou l'espace collaboratif à la mode des Ripostes Créative “Agora des archipels”. Les références citées sont relatées dans des articles descriptifs (Marseault & Briand 2021, Framasoft, 2019), état des lieux actuels de cette réflexion émergente.
Dans cette logique de relations entre îlots de l'archipel des Riposte, le webinaire inaugural de Riposte Créative Pédagogique a accueilli Animacoop pour s'imprégner des valeurs de la coopération ouverte et l'idée de cercle apprenant développée au CNFPT en 2021 est reprise au sein du groupe hybridation en coopération ouverte.
3. Une initiative au sein de l'enseignement supérieur
Après avoir décrit les dimensions principales de l'archipel des ripostes déployé en réponse à la crise, nous nous intéressons plus spécifiquement à l'initiative mise en place pour l'enseignement supérieur, à savoir Riposte Créative Pédagogique, et plus spécifiquement à sa deuxième phase, qui correspond au développement d'un groupe plus large que le noyau initial autour de l'hybridation des formations en coopération ouverte.
3.1. Une organisation informelle co-construite
Le groupe dit “hybridation des formations en coopération ouverte” a donc été initié après le premier confinement, à un moment où nombre de professionnels de l'enseignement supérieur étaient en recherche d'espace de partage et d'échanges ouverts, où dans le même temps l'anticipation pour gérer le prolongement de la crise sanitaire semblait absente des discours officiels. La naissance du groupe, suite à une proposition ouverte (Gilliot, 2020), s'est opérée au travers de deux réunions en ligne réunissant une vingtaine de personnes chacune, qui ont permis de poser les bases du groupe et de s'accorder sur les enjeux de celui-ci.
Le cadre de création proposé est celui de la coopération ouverte, autour des questions de l'hybridation des formations, central pour permettre la résilience de l'enseignement supérieur, et des ressources ouvertes comme moyen d'efficience. L'organisation se veut agile, et vise à permettre de travailler collectivement autour de ces questions. Cette agilité est rendue possible par un a priori de confiance (l'écriture est ouverte à tous) et un fonctionnement par consentement (une initiative est valide dès lors que quelqu'un la porte et que personne n'a d'objection de fond). Une telle organisation s'avère difficile à mettre en place dans le cadre d'un appel à projet ou dans un cadre institutionnel classique, où les attendus sont plus formalisés, et la participation de chacun prédéfinie, et cadrée par son métier.
Le groupe se veut ainsi un lieu d'échanges, de réflexion, mais aussi de montée en compétence collective sur les sujets de l'hybridation en formation, en intégrant les questions de collaboration et de partage de ressources. Il s'apparente ainsi à un environnement capacitant (Fernagu-Oudet, 2018), qui, couplé avec les capabilités mises en place par l'environnement numérique, va permettre aux participants de se saisir des opportunités offertes pour devenir acteurs et ainsi leur permettre de développer leur pouvoir d'agir (Vallerie, B. & Le Bossé, Y. 2006). La mise en place d'actions se fait sur une base d'engagement libre et se focalise sur des premiers webinaires, qui visent à accueillir une expertise, mais surtout à susciter le débat. Une réunion hebdomadaire, à laquelle chacun peut se joindre, permet la prise de contact et de faire avancer l'organisation des actions. Elle permet aussi une libération de la parole et l'échange d'informations, phase qui s'avère importante en temps de crise. Une liste de diffusion permet d'informer les adhérents. Le site innovation pédagogique, permet de diffuser les annonces au-delà du groupe. Le cadre informel facilite également l'articulation avec d'autres initiatives ouvertes, sur des sujets d'intérêt communs. Le choix de partager des webinaires ouverts est ainsi possible, renforçant de facto l'impact de chaque initiative. Au total, le groupe initial s'est enrichi pour accueillir 187 personnes inscrites sur la liste de diffusion.
3.2. Les webinaires témoins d'une demande implicite
De manière à répondre au mieux à la demande d'échanges et de partages de la communauté, des webinaires thématiques ont été rapidement co-organisés. Lors des réunions hebdomadaires des sujets sont proposés. Ils sont affichés sur le wiki du groupe hybridation en coopération ouverte et relayés sur la liste de diffusion avec le ou les nom(s) des personnes à contacter pour participer à la mise en place du webinaire. Une fois le déroulé défini, un formulaire d'inscription est mis en place afin de pouvoir suivre le nombre d'inscrits. Le lien de connexion ainsi que lien vers un outil de prise de notes collaboratives sont envoyés aux participants. Par la suite, les notes et l'enregistrement des webinaires sont déposés sur le wiki.
Cette organisation très agile a permis d'organiser de manière coopérative 18 webinaires entre octobre 2020 et juin 2021. Ces webinaires regroupent généralement entre 50 et 100 participants. Les premiers webinaires visaient à accueillir une expertise, mais surtout à susciter le débat autour de thématiques pédagogiques d'actualité (par exemple : “Motivation et engagement des étudiants : enjeux en contexte de formation hybride” animé par Denis Bédard). Par la suite, les webinaires se sont aussi orientés vers le partage de pratiques et les retours d'expérience (TP hybrides et à distance, jeux sérieux, le tutorat, …).
Ces webinaires et les échanges ont permis un développement professionnel des acteurs de la communauté ainsi qu'une diffusion de bonnes pratiques.
3.3 Ouverture des possibles
Le contexte mis en place, avec son degré informel et l'utilisation d'outils conviviaux permet également de tester facilement des idées. Certaines ne trouvent pas le succès escompté, et peuvent rapidement être abandonnées. Par exemple, un questionnaire a été mis en place au moment des re-confinements, mais n'a été rempli que par moins d'une centaine de participants malgré une diffusion large. D'autres peuvent par contre se prolonger au-delà du périmètre initial. Le webinaire sur les jeux documentaires a ainsi été prolongé par un second webinaire portant sur le test en réel d'un jeu et sur son mode de construction. Le questionnement sur la mise en place de TP hybrides a fait l'objet d'un webinaire, repris par d'autres, mais aussi d'une collecte de ressources. Le webinaire sur “Enseignant, conseiller pédagogique, collaboration ou coopération ?” a donné lieu à la création d'un cercle apprenant.
D'une simple base de ressources d'initiatives et de retours d'expériences, puis d'une collection de webinaires, le projet Riposte évolue maintenant vers un apprentissage entre pairs autour de cercles apprenants.
3.4. Une expérimentation ouverte : les cercles apprenants
Afin de prolonger les échanges provoqués par les webinaires, l'idée de cercle apprenant a été proposée afin de favoriser une plus grande coopération entre pairs. Ces temps de co-formation s'inscrivent dans la lignée des cercles d'apprentissage (Alix, 2021) mis en place par Riposte Créative territoriale (CNFPT). Le premier cercle apprenant mis en place dans le cadre du groupe hybridation en coopération ouverte concerne la thématique de la coopération/collaboration entre enseignant et conseiller pédagogique. En effet, lors du webinaire consacré à ce sujet les thèmes de l'accompagnement des équipes et de l'autonomie des acteurs par rapport à leur institution n'avaient pas été abordés. Il a donc été proposé de les discuter de manière plus coopérative dans un cercle apprenant. Pour chaque rencontre un animateur ou une animatrice se propose avec un déroulé s'appuyant sur une prise de notes collaborative sur un pad.
3.5. Impact au-delà du groupe
Le fonctionnement du groupe décrit dans cette contribution a donné à voir de nouvelles pratiques ouvertes, qui ont été reprises dans d'autres contextes. L'annonce des différents webinaires a été relayée par certaines institutions. Certains établissements (citons l'IFPEK, IMT Atlantique, ENTPE) ont ainsi pris l'habitude d'ouvrir les enregistrements de leurs webinaires, voire dans certains cas la possibilité de participer au-delà de leur établissement.
Dans cette démarche d'ouverture, les activités de la communauté du groupe hybridation ont pu aider des établissements, comme l'IFPEK, dans leur stratégie d'accompagnement du développement professionnel des enseignants/formateurs. Les ressources et initiatives produites ont pu servir d'exemple ou d'illustration à une transformation pédagogique pendant cette période de crise sanitaire. Une transformation pédagogique embryonnaire et souhaitée par la communauté des enseignants/formateurs de l'établissement, mais que le manque d'exemple ou de temps avaient pu freiner. La crise doublée d'un accès facilité aux ressources et aux activités des ripostes ont permis aux formateurs de s'autoriser à lancer cette transformation (“ils l'ont fait, on peut le faire”), tout en restant dans une philosophie de réutilisation et d'ouverture, pour alimenter à leurs tours par leurs initiatives la communauté.
4. Conclusion : un environnement capacitant en évolution
Ainsi que nous l'avons décrit, ce dispositif de coopération ouverte, au-delà d'un périmètre (pré)défini d'établissements, basé sur une organisation agile et des outils conviviaux a rencontré un accueil favorable auprès d'une communauté de près de 200 personnes. Un noyau assez large s'est saisi de ce dispositif en tant qu'environnement capacitant bienveillant, la variété des propositions permettant à différentes personnes de s'impliquer et de trouver leur place. Construit hors hiérarchie, cet espace permet de donner des capacités d'actions qui ont pu être réinvesties dans les institutions. Cette absence de cadrage a également permis de faire émerger des actions selon les intérêts de chacun, qui ont pu être validées, ou non, de manière agile. Cette communauté de pratique a ainsi permis d'aborder de nombreux sujets de manière originale et interprofessionnelle.
Notons que les participants français ont été étonnés de découvrir qu'il existait au Québec des initiatives encourageant la coopération ouverte (les rencontres avec le GRIIP (2020) et la fabrique des REL (2020) ont été riches d'échanges sur le sujet). Il serait intéressant de voir si de telles initiatives pourraient être soutenues de manière encore plus large, au-delà de quelques établissements.
Le fait de pouvoir s'inscrire dans un mouvement plus large au travers des Ripostes et de la logique d'archipels a clairement facilité la création d'un tel groupe. La situation de crise a été un facteur important. La maturité collective a semble-t-il augmenté. Ainsi, la tentative de créer une communauté de contributeurs autour du site Innovation Pédagogique depuis 2014 n'avait pas rencontré un grand succès. Aujourd'hui, avec une approche plus variée, une communauté ouverte se fédère effectivement autour d'un projet plus ciblé, avec des participants prêts à s'investir.
De nouvelles idées d'actions, de sujets continuent à être proposées. À l'heure d'écrire ces lignes, nous notons par exemple que l'annonce d'un groupe similaire sur la transition écologique qui intéresse tous les acteurs fait la proposition d'un espace de coopération ouverte sur ce sujet.
Jean-Marie Gilliot
IMT Atlantique – Lab-STICC (UMR CNRS 6285), Brest, France, jm.gilliot@imt-atlantique.fr
Yann Le Faou
IFPEK – CREAD EA3875 – Université de Rennes, Rennes, France, y.lefaou@ifpek.org
Éric Tanguy
Université de Nantes, Faculté des Sciences et des Techniques, Nantes, France, eric.tanguy@univ-nantes.fr
Michel Briand
IMT Atlantique, Brest, France, Michel.Briand@imt-atlantique.fr
4. Remerciements
Les auteurs de cet article remercient l'ensemble des participants au groupe et aux webinaires.
Références bibliographiques
Alix B. (2021, 10 février) Les cercles d'apprentissage, d'étude ou de pratique Riposte Créative Territoriale https://ripostecreativeterritoriale.xyz/?CercleApprentissage
Briand, M. (2019, 4 juillet) La coopération, un changement de posture : vers une société de la coopération ouverte, diapos commentées de la conférence QPES 2019. Innovation pédagogique https://www.innovation-pedagogique.fr/article5331.html
Fabrique, R. E. L. (2020). Ressources éducatives libres (REL).
Fernagu-Oudet, S. (2018). Apprenance et environnement capacitant. Penser la formation aujourd'hui : un nouveau paradigme, 25.
Framasoft (2019, 10 décembre) Archipélisation : comment Framasoft conçoit les relations qu'elle tisse. https://framablog.org/2019/12/10/archipelisation-comment-framasoft-concoit-les-relations-quelle-tisse/
Gilliot, J.M. (2020, 10 juin) Présence hybride ou la rentrée sous le signe de l'hybridation – préparons là ensemble ! repris sur Innovation Pédagogique https://www.innovation-pedagogique.fr/article7288.html
GRIIP (2020) Groupe d'intervention et d'innovation pédagogique https://pedagogie.uquebec.ca/
Illich, I. (1973). Tools for conviviality.
Latour, B. (2020). Imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise (Vol. 30, No. 03, p. 2020). AOC. http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/downloads/P-202-AOC-03-20.pdf
Les Jours Heureux (2017). Archipel « Osons les jours heureux » https://les-jours-heureux.fr/archipel-osons-les-jours-heureux/
Marseault L., & Briand M. (2021, 12 mars) Partage sincère, "tragédie du LSD", fonctionnement en archipel : dialogue autour de la coopération ouverte avec Laurent Marseault. Coopérations, http://www.cooperations.infini.fr/spip.php?article11428
Merlet, F., Marseault L., & Briand M. (2021, 4 avril) Le rôle du techno-pédagogue dans un « Riposte créative », espace en coopération ouverte. Coopérations, http://www.cooperations.infini.fr/spip.php?article1143
Sanojca E., & Briand M. (2018, 15 mai) La coopération ouverte, un concept en émergence. Innovation pédagogique https://www.innovation-pedagogique.fr/article3428.html
Vallerie, B., & Le Bossé, Y. (2006). Le développement du pouvoir d'agir (empowerment) des personnes et des collectivités : de son expérimentation à son enseignement. Les Sciences de l'éducation-Pour l'Ère nouvelle, 39(3), 87-100.
Wenger, E. (1998). Communities of Practice : Learning, Meaning, and Identity. Cambridge : Cambrige University Press .
Un article repris de la revue Distances et médiations des savoirs, (28 juin 2022) ; une publication sous licence CC by sa
Luc Massou, « Mutualisation des ressources pédagogiques numériques pour l'hybridation : vers l'éducation ouverte ? », Distances et médiations des savoirs [En ligne], 38 | 2022, mis en ligne le 09 juin 2022, consulté le 11 octobre 2022. URL : http://journals.openedition.org/dms/7997 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dms.7997
Une fois n'est pas coutume dans Distances et médiations des savoirs (DMS), ce n'est pas en tant qu'enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Lorraine que je vais m'exprimer pour contribuer à ce nouveau débat de la revue, mais comme conseiller scientifique et pédagogique rattaché à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP) du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR [1]). En effet, la thématique des stratégies numériques dans l'enseignement supérieur au prisme de la distance proposée par Daniel Peraya et Aurélien Fievez est en lien avec plusieurs missions et projets auxquels je contribue au sein du collège des conseillers scientifiques et pédagogiques (CCSP), dans le prolongement de l'ancienne Mission pour la pédagogie et le numérique dans l'enseignement supérieur (MiPNES) dont j'ai fait partie de 2017 à 2020 avant d'intégrer le collège. Pour autant, et conformément au principe de la rubrique « Débat-discussion » de la revue, il s'agit bien ici d'exprimer un point de vue personnel qui n'engage donc que moi, mais qui prend appui sur cette expérience acquise en tant que conseiller sur plusieurs initiatives et projets en lien avec l'hybridation des formations du supérieur en France, depuis le premier confinement de mars 2020 à aujourd'hui.
Pour inscrire mon propos dans le prisme de la distance, j'ai choisi l'angle de la mutualisation des ressources pédagogiques numériques produites ou mises à disposition pour accompagner le passage contraint et massif au tout distanciel, puis à l'hybridation davantage choisie et progressive des formations dans les établissements de l'enseignement supérieur français, que Daniel Peraya et Aurélien Fiévez appellent « mise à distance » dans leur texte introductif du débat. J'entends ici l'hybridation pensée selon les deux premières catégories de la récente revue de littérature publiée par Claire Peltier et Catherine Séguin (2021) dans DMS : centrée sur les modalités d'organisation de la formation à travers l'articulation présence/distance et l'usage des technologies (catégorie 1) ; centrée sur le processus d'ingénierie et les choix technopédagogiques (catégorie 2). Pour l'illustrer, je citerai plusieurs exemples à la fois de politiques publiques initiées par le MESR et la DGESIP depuis mars 2020 et de projets d'établissements (collectifs ou individuel) ayant intégré cette dimension de la mutualisation des ressources pédagogiques numériques de manière parfois centrale. Cette sélection d'exemples et de stratégies numériques va dans le sens d'accompagner, mais aussi de capitaliser sur l'expérience acquise depuis les différents confinements (avec passages à un tout distanciel brutal et souvent dégradé en raison de l'urgence : Hodges et al. ; Bailenson, 2021), non pas pour défendre l'idée que le distanciel doive devenir la norme dans l'enseignement supérieur français, mais pour accompagner et prolonger les changements identifiés ici et là dans les pratiques pédagogiques des enseignants du supérieur avec le numérique, et que la littérature scientifique commence à recenser (Demeyer 2020 ; Karsenti et al., 2020 ; Loisy 2020 ; Roy et al., 2020 ; Miras et Burrows 2021 ; Papy 2021 ; Poellhuber et al., 2021).
Enfin, je proposerai en guise de conclusion d'élargir le débat à une réflexion personnelle sur l'éducation ouverte (open education) et la perspective potentielle d'un « plan national pour l'éducation ouverte » (PNEO) qui deviendrait le pendant ou miroir du plan national pour la science ouverte (PNSO) lancé en 2018 et qui vient d'être récemment prolongé pour 2021-2024 par notre ministère : serait-il pertinent de l'appliquer aussi aux ressources pédagogiques numériques (ressources éducatives libres) ?
Quelles politiques publiques en France depuis le premier confinement ?
Pour introduire mon propos, il me semble utile de rappeler certains choix opérés par le ministère et par le Gouvernement depuis le premier confinement de mars 2020, afin d'accompagner l'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur français pendant et après la crise pandémique. Ils se déclinent en trois principales catégories d'action : accompagnement des acteurs, financement de projets, valorisation d'initiatives.
Accompagnement des acteurs
Il a pris trois formes. Tout d'abord la publication en juin 2020 du guide « Préparer la rentrée universitaire 2020 » [2], rédigé par des conseillers et personnels permanents de la MiPNES à destination des équipes pédagogiques et services d'appui à l'enseignement, afin de dégager des repères collectifs et flécher vers des ressources déjà disponibles en ligne pour guider les enseignants dans leur préparation d'une rentrée universitaire 2020/2021, où l'enseignement distanciel allait prendre une place prépondérante (évaluée au minimum à 70 % des enseignements par les établissements à cette période, en raison de la pandémie). Le guide était structuré autour de quatre axes de travail qui nous semblaient essentiels à prendre en compte dans un tel contexte inédit : le séquençage des activités d'enseignement-apprentissage ; la conception d'un cours en ligne ; l'engagement et l'accompagnement des étudiants dans un enseignement en ligne/à distance ; l'évaluation. Pour chacun, nous avions énoncé quelques conseils clés (par exemple : développer le sentiment d'appartenance et la socialisation à distance pour favoriser la réussite étudiante, évaluer finement la charge de travail pour les enseignants et les étudiants dans le basculement des enseignements et apprentissages à distance…) et pointé vers des liens qui nous semblaient pertinents et utiles, comme la frise interactive sur la scénarisation d'un cours en ligne « Défi Distance ! » de l'Université catholique de Louvain ou la cartographie interactive à plusieurs entrées « Enrichir ses cours grâce au numérique » de l'Université de Bourgogne.
Ensuite, nous avons décidé au sein du comité de pilotage du MOOC « Se former pour enseigner dans le supérieur » d'ajouter un sixième thème sur « Enseigner et apprendre en ligne », étant donné que ce cours en ligne massif et ouvert est devenu une ressource pédagogique de référence en France, suivi par 10 000 inscrits en moyenne chaque année depuis son lancement (première session) en novembre 2017. Il vise la formation initiale et continue des enseignants-chercheurs, mais touche aussi les personnels d'appui à l'enseignement (ingénieurs et conseillers pédagogiques), comme l'avait démontré l'étude des publics et usages du MOOC que nous publiée dans DMS (Delalande et al., 2019).
Enfin, beaucoup plus récemment, l'appel à manifestation d'intérêt « Compétences et métiers d'avenir » lancé en décembre 2021 pour 4 ans (2021-2025) par le 4e plan d'investissements d'avenir (PIA) dans le cadre du plan « France 2030 » comprend un volet dirigé sur la thématique « Enseignement et numérique » dans lequel notre groupe de travail ANR-SGPI-DGESIP[Agence nationale de la recherche (ANR), Secrétariat général pour l'investissement (SGPI).]] a identifié – entre autres – trois actions fléchées sur la formation des enseignants au numérique : « Formation initiale à l'enseignement et au numérique pour les néo et futurs enseignants » (action 1) ; « Soutien à la formation continue sur l'enseignement et le numérique et au développement professionnel des enseignants de l'enseignement supérieur » (action 2) ; « Développer l'offre de formation initiale et continue en ingénierie et en accompagnement pédagogiques » (action 4). Ces actions visent notamment à renforcer les compétences dans l'usage pédagogique du numérique des enseignants-chercheurs et à améliorer le vivier – actuellement insuffisant - des personnels d'appui à la pédagogie et au numérique, très recherchés par les établissements d'enseignement supérieur français.
Financement de projets
Sur le financement de projets visant l'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur, trois principaux appels à projets (AAP) ou à manifestation d'intérêt (AMI) sont venus accompagner entre juin 2020 et mars 2021 des projets d'établissements portant spécifiquement sur l'hybridation de leurs cursus et/ou leur transformation numérique. Le plus emblématique est l'AMI « Hybridation des formations de l'enseignement supérieur » lancé très rapidement (AMI dit « flash » pour ses délais de publication et de sélection très courts) en juin 2020 suite au premier confinement, afin de faire face à l'urgence de préparation d'une rentrée universitaire 2020/2021 en mode hybride dans tous les établissements d'enseignement supérieur français, et d'anticipation de gestion de crise pandémique future dont personne ne pouvait savoir comment elle allait évoluer. Dès cet appel est cité l'objectif de proposer des « ressources pédagogiques mutualisées et modulaires » (p. 3 du texte de l'AMI), de faire la démonstration (par les établissements) « de leur expérience et de leurs compétences en matière de mutualisation et de diffusion des formations numérisées à l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur » (p. 5), et de mutualiser les modules de formation à distance « grâce à leur mise à disposition sur une plate-forme » (p. 6). Sur 65 projets jugés recevables, 34 projets ont reçu le soutien de cet AAP via le PIA 3 (15 lauréats initiaux) ou le Plan de relance (19 lauréats supplémentaires), et sont encore en cours de développement.
Un autre AAP l'a suivi, lié au projet « Parcours flexibles en licence » (PFL) du MESR et lauréat du fonds de transformation de l'action publique (FTAP) en novembre 2018, et qui s'est décliné en deux AAP internes à l'enseignement supérieur français en 2019 puis 2020. Ainsi, son 2e AAP « Parcours flexibles en licence - médecine – maïeutique – odontologie – pharmacie » (PFL-MMOP), lancé en décembre 2020 et dont je coordonne le suivi pour la DGESIP, a ciblé plus particulièrement la mise en œuvre de la réforme des études de santé en s'appuyant sur une formation partiellement hybridée, accompagnée d'un tutorat pédagogique et méthodologique renforcé, et en combinant les bénéfices des outils et ressources pédagogiques numériques et de l'enseignement en présentiel. Là encore, l'objectif de favoriser la mutualisation des ressources pédagogiques numériques est central, mais avec la particularité de la mettre en œuvre au sein de consortiums d'établissements. 4 consortiums représentant plus de 30 universités différentes sont ainsi actuellement financés par les deux AAP (2019 et 2020) du projet PFL, dans le domaine des études de santé ou de sport en particulier.
Enfin, mais dans une moindre mesure étant donné son approche beaucoup plus globale de soutien aux stratégies numériques menées au sein des établissements et à leur capacité à les essaimer au-delà de leur seul périmètre interne, l'AMI « Démonstrateurs numériques dans l'enseignement supérieur » lancé en mars 2021 vise également à financer des projets qui répondent à des objectifs de transformation des métiers de l'enseignement supérieur grâce au numérique, incluant la diversification des modalités d'enseignement et d'apprentissage (hybridation, distance, simulation/expérimentation virtuelle, mobilité) et la formation des acteurs (apprenants, enseignants, personnels d'appui). 17 projets sont actuellement financés par cet AAP, pour une durée de 3 ans (2022-2024).
Valorisation des initiatives
Dans une perspective de valorisation des actions menées par les établissements français depuis la crise sanitaire, la DGESIP a également mis en ligne la cartographie « Les initiatives des acteurs du supérieur #Covid19 », alimentée par les acteurs eux-mêmes (732 notices publiées à ce jour, dans un format volontairement court) afin de partager leurs expériences de gestion de la crise sanitaire à de multiples niveaux (psychologique, culturel, médical, scientifique, pédagogique, administratif…). Afin de faciliter sa navigation, elle est structurée selon 20 thématiques transversales (dont l'une concerne « Apprendre et travailler à distance ») et propose un filtre par zones géographiques (grandes régions, DOM-TOM).
Le cas spécifique de la plateforme nationale FUN-Ressources
Pour terminer ce panorama sélectif des récentes politiques publiques en faveur de l'accompagnement à l'hybridation des formations du supérieur, il est intéressant d'expliquer les principes clés à l'origine du lancement de la plateforme FUN-ressources, co-pilotée par la DGESIP, l'Université numérique (UN, association des Universités thématiques numériques - UNT) et France Université numérique (FUN, gestionnaire de la plateforme FUN-MOOC), et visant à proposer un ensemble de ressources et d'outils pédagogiques numériques à destination des enseignants et services d'appui, pour faciliter l'hybridation de leurs formations. Dès sa conception durant le premier confinement en mars-avril 2020, la plateforme a d'abord été pensée comme un espace solidaire et contributif de dépôt de ressources pédagogiques issues de l'enseignement supérieur et de la recherche, appelé « Je contribue » et fonctionnant comme un Cloud hébergé par FUN et permettant aux enseignants volontaires de partager leurs ressources pédagogiques à l'attention de leurs pairs. Très vite, un comité de pilotage DGESIP-UN-FUN a permis d'élargir le dispositif à deux autres briques fonctionnelles dès juin 2020 :
« Découvrez » : une sélection de ressources pédagogiques numériques13 (ressources éducatives libres - REL) issues du catalogue des UNT et de FUN-MOOC et organisées par mentions nationales de Licence et de DUT ;
« Utilisez » : un accès au service FUN-Campus qui permet d'implémenter dans chaque établissement en local (comme un SPOC) des MOOC issus du catalogue de FUN-MOOC.
La première brique vise à répondre à trois des principales étapes identifiées dans la littérature scientifique sur l'appropriation des REL par les enseignants (Cox et Trotter, 2017), et qui peuvent expliquer leur non-usage actuel (Massou, Papi, Pulker, 2020) : la prise de conscience de ce que sont les REL et de leur spécificité par rapport aux autres ressources éducatives ; la capacité à les trouver ; la disponibilité de ressources pertinentes et de qualité. En proposant une liste sélective de REL validées par les UNT et par les établissements partenaires de FUN-MOOC, et organisées par mentions nationales et années de diplômes de premiers cycles universitaires, la brique « Découvrez » de la plateforme FUN-Ressources permet aux enseignants et personnels d'appui à la pédagogie en recherche de REL utiles et de qualité d'être guidés dans leur démarche, et de pouvoir les choisir en connaissance de cause (fiche descriptive, granularité de la ressource, type). D'une certaine façon, cette brique joue le rôle de courtage éducatif décrit par Pierre Moeglin (2007) comme intermédiaire nécessaire entre ressources pédagogiques numériques et usagers (les enseignants ici), et qui était selon lui le chaînon manquant dans les campus numériques du début des années 2000, dont les UNT sont en partie issues.
Le premier bilan de la plateforme effectué par notre comité de pilotage en février 2021 nous a conduit à supprimer la brique « Je contribue/contribuez » de dépôt de ressources pédagogiques (qui n'a pas rencontré le succès escompté), de maintenir les briques « Découvrez » et « Utilisez », et surtout de préparer l'ouverture d'une nouvelle brique « Accédez » qui est opérationnelle depuis mars 2022. Elle consiste en un entrepôt national proposé par l'Université numérique, implémenté sous Moodle (car très majoritairement choisi par les établissements d'enseignement supérieur en France) et accessible notamment par fédération d'identité (les enseignants y accèdent avec leur identifiant universitaire numérique déjà utilisé dans leur établissement d'affectation). Il est alimenté par des REL déjà sélectionnées dans la brique « Découvrez » et dont le format est compatible avec Moodle. L‘objectif est ici de pallier un autre frein dans la réappropriation des REL (Pulker, 2020) : la possibilité pour l'enseignant de les modifier à sa guise afin qu'elles correspondent à ses besoins. En les encapsulant dans un entrepôt de données compatible avec l'environnement Moodle et facilement accessible, L'Université Numérique permet aux enseignants de télécharger des ressources pédagogiques qu'un enseignant jugera utiles pour préparer son cours (à distance ou hybride), de les modifier une fois ré-importées dans son propre environnement numérique d'enseignement (le Moodle de son établissement), et de les redistribuer sous une nouvelle version s'il le souhaite. Avec l'ajout de cette nouvelle brique, c'est le cycle vertueux des 5 permissions (5R) que David Wiley (2014) a décrites pour définir les REL qui est visé : retenir, réutiliser, réviser, remixer, redistribuer.
Quatre exemples de projets d'établissements axés sur la mutualisation et l'ouverture des ressources pédagogiques numériques
Afin d'illustrer des choix stratégiques numériques d'établissements axés sur la mutualisation des ressources pédagogiques, j'ai d'abord choisi trois exemples issus de projets que je suis en tant que conseiller DGESIP, qui sont lauréats de deux AAP évoqués supra, et dont le point commun est d'être fondés sur une collaboration de plusieurs établissements partenaires. Puis je terminerai par un exemple unique en France de projet d'établissement dont la stratégie de site universitaire est axée sur l'ouverture à tous les niveaux (université ouverte), incluant l'open education sur laquelle nous reviendrons en conclusion. Dans les premiers cas, il s'agit de sortir d'une logique spécifique à un seul site universitaire, et où la mutualisation consiste à ne pas réinventer la roue pour des enseignements disciplinaires similaires, et à favoriser la flexibilisation des parcours de formation grâce à l'hybridation (par exemple, via l'articulation de cours en ligne en autonomie et de séances d'accompagnement personnalisé en présentiel), notamment pour les filières accueillant des publics massifs, spécifiques ou empêchés. Dans le second cas, il s'agit de penser l'ouverture pour toutes les dimensions d'une université publique française : science, éducation, innovation et gouvernance.
Concevoir des micro-contenus pédagogiques numériques (projet PUNCHY)
Ce premier exemple est issu d'un projet lauréat du fonds d'amorçage de l'AAP « Hybridation des formations de l'enseignement supérieur » en 2020 : « Partageons université numérique et cursus hybrides » (PUNCHY) est porté par l'association L'Université numérique (association regroupant 6 UNT, dont sont membres une grande partie des établissements – écoles, instituts, universités - de l'enseignement supérieur français) avec 2 universités partenaires et la Fédération interuniversitaire d'études à distance (FIED). Il vise à proposer une démarche générale, systémique et collective, de création de ressources numériques à large potentiel de réutilisation et d'adaptation à des contextes divers, supports de formations complètes, et qui ont vocation à devenir des documents de référence. Pour cela, les porteurs du projet ont défini un cahier des charges très précis afin de définir ce que recouvre la notion de « micro-contenu » pédagogique numérique, et dont le guide d'accompagnement pour les auteurs (p3) indique :
« Un micro-contenu est une courte séquence e-learning présentant une unité pédagogique élémentaire correspondant à une notion de cours. Il peut être utilisé de manière autonome ou inséré comme composant d'une ressource numérique plus globale. Sa particularité réside en sa capacité à être réutilisé dans plusieurs dispositifs pédagogiques. Un micro-contenu est autonome et décontextualisé afin de pouvoir être inséré dans d'autres contextes, indépendants de celui pour lequel il a été conçu à l'origine. L'assemblage de micro-contenus doit permettre à son auteur ou à d'autres enseignants de créer de nouvelles ressources complètes, ou d'enrichir des ressources existantes de manière à améliorer leur adaptabilité ».
Pour atteindre cet objectif de réutilisabilité, essentiel comme je l'avais déjà évoqué supra pour favoriser la réappropriation de REL mutualisées à grande échelle, la conception d'un micro-contenu doit répondre à un ensemble d'exigences éditoriales, là encore citées par le guide auteur du projet (p. 3) :
- « Un contenu comprenant une intentionnalité pédagogique autour d'une notion spécifique ;
- Un composant unitaire, pédagogiquement indivisible, d'une durée limitée à 30 minutes maximum temps apprenant ;
- Un contenu intégrant des apports pédagogiques (ressources et/ou activités), proposant les moyens pour les apprenants de s'auto-évaluer ;
- Un contenu s'appuyant sur une ou plusieurs activités d'apprentissage enchaînées pédagogiquement ;
- Un contenu décontextualisé, sans référence temporelle ou à des prérequis (qui peuvent exister, mais qui ne sont pas spécifiquement exprimés dans le contenu autrement que par des métadonnées). »
D'une certaine manière, je pense que ce choix marque une étape dans le modèle éditorial des UNT, que Laurent Petit (2009) considérait préalablement – et à juste titre – comme double, oscillant entre tentation de la chaîne éditoriale (incorporant la médiation, la scénarisation et l'instrumentation de choix pédagogiques) et formule du meccano industriel (comprenant des grains standardisés, indexés et ré-agençables par les enseignants). Ici, le choix est clairement opéré pour le second modèle, tout en luttant contre l'éclectisme didactique repéré par Matthieu Cisel (2017) dans son analyse des MOOC. Et si je m'en tiens à plusieurs réactions d'autres projets lauréats du fonds d'amorçage de l'AAP à la présentation du projet PUNCHY lors d'un webinaire de partage d'expériences inter-projets que notre collège des conseillers avait organisé en juin 2021, l'accueil favorable a confirmé la pertinence de ce choix. À ce cahier des charges s'ajoutent des caractéristiques techniques qui favorisent l'interopérabilité et la standardisation des micro-contenus (dont le format H5Pqui s'impose progressivement pour la production de REL à l'échelle internationale), pour les rendre compatibles avec la majorité des environnements numériques d'enseignement et d'apprentissage actuellement utilisés dans l'enseignement supérieur. Précisons enfin que les REL produites dans le cadre de ce projet viendront alimenter l'entrepôt de données ouvertes mis en place par l'Université Numérique dans le cadre de la plateforme nationale FUN-Ressources citée supra.
Construire une bibliothèque numérique mutualisée à très large échelle (projets HYBRIDIUM Santé et FLEXISANTÉ)
Ce deuxième exemple s'inscrit dans le cadre spécifique des études de santé, et de sa réforme du premier cycle appelée R1C, qui prévoit notamment la création de davantage de passerelles entre filières de santé et celles des autres disciplines universitaires, notamment par l'instauration de mineures en santé et de mineures disciplinaires permettant de diversifier et de flexibiliser les parcours et les profils des apprenants. C'est dans ce cadre de réforme nationale qu'UNESS, UNT en Santé et Sports dont sont membres 42 universités françaises, a été lauréate à deux reprises des AAP précités en 2020 : projet HYBRIDIUM Santé (AAP « Hybridation des formations de l'enseignement supérieur ») et projet FLEXISANTÉ (AAP « Parcours flexibles en Licence – MMOP »). Pour le second, le partenariat inclut également L'Université Numérique et un consortium de 22 universités, sous l'impulsion des conférences des Doyens de Médecine, de Maïeutique, de Pharmacie et d'Odontologie (MMOP). Dans ces deux projets, j'ai identifié un objectif commun : celui d'alimenter une banque numérique mutualisée de ressources pédagogiques ouvertes à ces consortiums nationaux d'établissements proposant des parcours avec accès spécifique santé (PASS) et/ou des Licences avec accès santé (L.AS), qui permettent un usage pédagogique en hybridation partielle ou totale des enseignements prévus dans le cadre des modules de formation aux sciences de la santé, mais également aux disciplines hors santé (qui recouvrent des domaines disciplinaires très diversifiés : économie, gestion, sports, psychologie, sciences de l'ingénieur…).
C'est l'ampleur des partenariats mobilisés et de la mutualisation potentielle des usages de ces banques numériques qui impressionne ici, avec des référents pédagogiques issus des 35 UFR de Santé en France et répartis par comités pédagogiques multidisciplinaires dans les 10 grandes régions françaises (DOM-TOM inclus) pour le premier projet, et un consortium de 22 établissements partenaires dans l'autre. À cette échelle, une méthodologie commune de conception des ressources pédagogiques numériques en mode à la fois collaboratif et mutualisé est proposée, même si le niveau d'ouverture n'est pas toujours aussi poussé que dans le cas précédent des micro-contenus décontextualisés et modifiables. Pour le projet HYBRIDIUM Santé, elle se décline ainsi :
- s'accorder sur un référentiel de compétences commun ;
- proposer un format standardisé de capsules pédagogiques correspondant à des unités individuelles d'enseignement (incluant une ressource principale, des ressources complémentaires et une aide à l'acquisition de connaissances), dans le même esprit que les micro-contenus du projet PUNCHY ;
- signer une convention de cession des droits d'auteurs en licence Creative Commons (BY-NC-ND) entre les enseignants auteurs et leur université, qui soit non exclusive, sans usage commercial, mais également dont le contenu n'est pas modifiable sans l'accord de l'auteur, et dont la rétroaction est possible sans condition à la fin de l'année universitaire ;
- offrir une formation à la pédagogie hybride à destination des équipes pédagogiques visées par l'usage de cette bibliothèque.
Ici, on voit que le modèle juridique retenu propose un compromis entre une mutualisation potentielle des ressources pédagogiques numériques à très grande échelle et une convention de cession des droits qui protège leurs auteurs, et leur permette d'en garder un certain contrôle sur son usage futur par leurs pairs.
Co-concevoir des ressources pédagogiques mutualisées et ouvertes entre pairs (projet SHIFT)
Le troisième exemple retenu est issu du projet Licence « Staps Hybride Interuniversitaire Flexible Tutorée » (SHIFT) lauréat de l'AAP « Parcours flexibles en Licence » en 2019 et piloté par la branche Sports de l'UNESS, en partenariat avec 12 universités proposant des filières en sciences et techniques des activités physiques (STAPS). Il m'a intéressé par l'originalité de sa démarche de conception de ressources pédagogiques numériques pour l'hybridation et la flexibilisation de ces filières en tension, notamment à destination des publics empêchés (sportifs de haut niveau, étudiants salariés). La méthodologie adoptée est la suivante :
- s'accorder entre pairs par des conférences de consensus, en lien avec les sociétés savantes, sur les ressources pédagogiques à construire collectivement, en vérifiant qu'elles s'inscrivent dans les référentiels de formation existants ;
- co-concevoir chaque ressource selon trois niveaux possibles de contribution : coordinateur (responsable du consensus et de l'alignement pédagogique des ressources produites), concepteur (créateur de la ressource mutualisée à partir des contenus des contributeurs), contributeurs (partagent leurs contenus et ressources pédagogiques numériques) ;
- signer collectivement la ressource ainsi produite, en licence Creative Commons.
Dans ce troisième exemple issu d'un projet porté par un consortium d'établissements, c'est la dynamique de conception collective (et non individuelle) et inter-établissements de ressources pédagogiques mutualisées qui fait la différence, en valorisant leur signature collective (comme c'est le cas pour la publication scientifique) et le consensus acquis en amont par les pairs, afin de favoriser leur légitimité et leur appropriation future par une communauté d'enseignants plus large.
Construire une université ouverte (Nantes Université)
Mon quatrième et dernier exemple s'appuie sur la récente présentation du projet d'établissement de Nantes Université par son équipe présidentielle lors de la conférence internationale Open Education Global en mai 2022 : celui d'une université ouverte. Unique en son genre en France, il s'appuie sur le principe de l'ouverture (open) considérant que les connaissances financées sur fonds publics doivent être accessibles de manière ouverte et gratuite (libre) avec le numérique, mais il le généralise à plusieurs échelles dans le projet du nouvel établissement Nantes Université créé en janvier 2022 [3]. Les quatre principaux volets de ce projet d'ouverture sont les suivants :
- science ouverte : publications ouvertes (dont dépendent l'évaluation et le financement des unités de recherche de l'université), gestion des données de la recherche (ouverture, plan de gestion, réutilisabilité, respect de la démarche FAIR [4]), gestion des archives ouvertes de l'université par les services communs de documentation ;
- éducation ouverte : nomination d'un vice-président délégué à la formation et à l'éducation ouverte (également unique en son genre en France), ouverture des REL produites à tous les membres de l'université (étudiants, personnels) et à des partenaires nationaux (universités, UNT) et internationaux, formation des communautés d'acteurs (personnels, étudiant), test de nouveaux cursus pilotes fondés sur les principes de l'éducation ouverte, développement d'un environnement immersif virtuel et ouvert, création d'un environnement numérique ouvert et durable ;
- innovation ouverte : accès à des terrains d'expérimentation et développement d'une expertise interdisciplinaire pour les chercheurs, association des partenaires socio-économiques et des usagers dans les processus d'innovation collective ;
- gouvernance ouverte : développement de la démocratie participative sur les missions et choix de l'université (votes, consultations collectives, amendements issus du terrain, conférences participatives…), données ouvertes sur la gouvernance de l'établissement.
La question de la mutualisation des ressources pédagogiques numériques fait donc bien partie de cette stratégie d'établissement originale et sans réel équivalent en France à ce jour, avec pour projet de contribuer à leur diffusion en dehors de l'établissement et de ses partenaires actuels, mais on voit bien qu'elle s'intègre dans une logique de l'ouverture qui dépasse largement cette seule question et qui irrigue une grande partie de la politique générale de l'établissement.
Pour conclure provisoirement : vers l'opportunité d'un plan national en éducation ouverte ?
En guise de conclusion provisoire, je souhaite poser la question de l'opportunité d'un plan national en éducation ouverte, qui s'inspirerait de la démarche initiée par le Plan national pour la science ouverte (PNSO) lancé en juillet 2018 par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation en France. En effet, pourquoi ne pas appliquer à l'éducation ouverte ce qui a fonctionné pour la science ouverte dans les établissements de l'enseignement supérieur français ? Comment insuffler la même dynamique de valorisation nationale des politiques d'établissement et des pratiques des acteurs en faveur de l'ouverture de leurs ressources pédagogiques numériques, au-delà des stratégies politiques et institutionnelles évoquées dans mon texte ? Dans un contexte de sortie de crise pandémique à l'échelle internationale, où le présentiel a repris toute sa place, mais où les pratiques, les ressources techniques et pédagogiques - et plus globalement l'écosystème - numériques des acteurs de l'enseignement supérieur ont également évolué, avec une montée en compétences et en capacité significative dans les services d'appui à la pédagogie et au numérique, réfléchir à un tel plan ne paraît pas incongru.
Pour cela, s'appuyer sur le bilan du PNSO 2018-2021 et son deuxième volet 2021-2024 permet de dresser ci-dessous quelques pistes d'actions (non exhaustives) que j'ai transposées au domaine spécifique de l'éducation ouverte, que je livre ici pour amorcer la réflexion :
- généraliser l'accès ouvert aux ressources pédagogiques financées sur fonds publics ;
- soutenir les archives ouvertes mutualisées et simplifier le dépôt pour les enseignants ;
- indexer les REL dans les outils de découverte proposés par les bibliothèques, au même titre que les autres publications ;
- créer les conditions et promouvoir l'adoption d'une politique de ressources éducatives libres dans les établissements, qui prenne appui sur l'évaluation entre pairs et la conception collective (co-design) de ressources mutualisées ;
- développer les compétences en matière d'éducation ouverte chez les acteurs (notamment enseignants et apprenants), en s'appuyant par exemple sur le référentiel de compétences REL publié par l'Organisation internationale de la Francophonie en 2016 et actuellement sous-exploité ;
- mobiliser les acteurs de l'enseignement supérieur au sein d'un Comité pour l'éducation ouverte, qui associe également des représentants des services d'appui et des services de documentation pour améliorer les fonctions indispensables de courtage éducatif ;
- clarifier le choix des licences ouvertes (comme les Creative Commons) pour publier et protéger les REL, notamment pour un éventuel usage commercial ;
- soutenir les modèles économiques d'édition pédagogique en accès ouvert.
L'intérêt d'un tel plan serait de ne plus se limiter à des stratégies de projets. d'établissement disparates, en s'accordant sur la définition d'un cadre national qui fasse consensus pour mieux valoriser l'engagement institutionnel et professionnel dans l'éducation ouverte, dont la mutualisation des ressources pédagogiques n'est qu'une dimension nécessaire, mais pas suffisante. Car il s'agit bien ici de ne pas se limiter à une simple rhétorique de l'ouverture (Gruson et al., 2019), mais de contribuer à l'ancrer dans la professionnalité même des universitaires, comme cela est maintenant communément acquis et reconnu pour les pratiques de science ouverte. Et comme le PNSO, il s'agit aussi de s'inscrire dans une dynamique internationale sur les REL dont les illustrations se sont accélérées depuis quelques années, parmi lesquelles (liste non exhaustive) : les recommandations de l'UNESCO (2019) ; la création en 2019 de la coalition dynamique REL de l'UNESCO (dont fait partie l'Open Education Consortium) ; la Fabrique REL créée en 2019 par les Universités de Sherbrooke, Montréal et Laval ; le portail de REL Edusources2 aux Pays-Bas ; le lancement des webinaires de l'Open Education Global francophone en 2021 (coordonnés par l'Université de Lille) ; la création du groupe de travail sur les REL en Afrique francophone coordonné par l'International Council for Open and Distance Education (ICDE) en collaboration avec l'UNESCO, le MESR et l'Université Numérique. Le chantier est certes important, mais son opportunité mérite très certainement d'être posée pour capitaliser sur les expériences acquises depuis la création des campus et universités numériques en France, et dans le prolongement beaucoup plus récent de l'enseignement hybride durant la crise sanitaire.
Bibliographie
Des DOI sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l'outil d'annotation bibliographique d'OpenEdition.
Les utilisateurs des institutions qui sont abonnées à un des programmes freemium d'OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lequelles Bilbo a trouvé un DOI.
Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal Overload : A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue. Technology, Mind, and Behavior, 2(1). https://doi.org/10.1037/tmb0000030
DOI : 10.1037/tmb0000030
Cisel, M. (2017). Le MOOC vu comme un projet d'apprentissage. Education & Formation, e-307-02, 98-109. http://revueeducationformation.be/include/download.php?idRevue=27&idRes=282
Cox, G. et Trotter, H. (2017). Factors shaping lecturers' adoption of OER at three South African universities. Dans C. Hodgkinson-Williams et P. Arinto (dir.), Adoption and impact of OER in the Global South (p. 287-347). https://www.oerknowledgecloud.org/archive/Cox&Trotter-chapter-draft-review.pdf
Delalande, P., Lalle, P., Massou, L., Nocera-Picand, C. et Younes, N. (2019). Quels usages d'un dispositif de formation continue en ligne à la pédagogie universitaire ? Distances et médiations des savoirs, 2019(26). http://journals.openedition.org/dms/3532
DOI : 10.4000/dms.3532
Demeyer, R. (2020, novembre). Effets perçus du confinement sur leurs pratiques d'enseignement par les enseignants-chercheurs de l'académie de Lyon : analyse qualitative comparée. Dans : Journée d'étude Enseigner et apprendre à distance : vers une mutation de la forme scolaire ? Des enjeux pour les métiers de l'éducation, Institut français de l'éducation.
Gruson-Daniel, C., Aïm, O., Sherlaw, K-W. et Depoux, A. (2019). Des MOOC aux OC (online courses) : les rhétoriques de l'ouverture. Dans L. Massou, B. Juanals, P. Bonfils et P. Dumas (dir.), Sources ouvertes numériques : usages éducatifs, enjeux communicationnels (p. 25-44). PUN-Éditions Universitaires de Lorraine.
Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust T. et Bond, A. (2020). The difference between emergence remote teaching and online teaching. Educase review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
Karsenti, T., Poellhuber, B., Roy, N. et Parent, S. (2020). Le numérique et l'enseignement au temps de la COVID-19 : entre défis et perspectives – Partie 1. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 17(2), 1-4. https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n2-01
DOI : 10.18162/ritpu-2020-v17n2-01
Loisy, C. (2020, novembre). Enseigner dans le supérieur à l'heure de la pandémie. Analyse de réponses au questionnaire diffusé par l'IFÉ et questions soulevées. Dans : Journée d'étude Enseigner et apprendre à distance : vers une mutation de la forme scolaire ? Des enjeux pour les métiers de l'éducation, Institut français de l'éducation.
Massou, L., Papi, C. et Pulker, H. (2020). Des ressources aux pratiques éducatives libres : quelle réappropriation dans la formation ouverte et à distance ? Distances et médiations des savoirs, 2020(31). http://journals.openedition.org/dms/5338
Miras, G. et Burrows, A. (2021). Pédagogie à l'université française et crise sanitaire : pratiques (pas si) exceptionnelles ou transformations durables ? Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 18(1). https://www.ritpu.ca/files/numeros/112/ritpu-v18n1-17.pdf
Moeglin, P. (2007). Le professeur et le courtier. Études de communication, numéro spécial, 111-132
DOI : 10.4000/edc.588
Papi, C. (2021). Enseignement à distance : source de renouveau pédagogique ? La Conversation. https://theconversation.com/enseignement-a-distance-source-de-renouveau-pedagogique-151625
Peltier, C. et Séguin, C. (2021). Hybridation et dispositifs hybrides de formation dans l'enseignement supérieur : revue de la littérature 2012-2020, Distances et médiations des savoirs, 2021(35). http://journals.openedition.org/dms/6414
Petit, L. (2009). Les conditions de l'usage des ressources pédagogiques numériques. Questions de communication, 2009(16), 249-264. https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/362
DOI : 10.4000/questionsdecommunication.362
Poellhuber, B., Karsenti, T., Roy, N. et Parent, S. (2021). Le numérique et l'enseignement au temps de la COVID-19, entre défis et perspectives – Partie 3. Enseigner à distance en temps de pandémie : réflexion sur les défis et les succès d'une adaptation dans l'urgence pour les formateurs universitaires. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 18(1), 1-2. https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-01
DOI : 10.18162/ritpu-2021-v18n1-01
Pulker, H. (2020). Impact of reappropriation of open educational resources on distance and online language teaching. Distances et médiations des savoirs, 2020(31). http://journals.openedition.org/dms/5292
DOI : 10.4000/dms.5292
Roy, N., Karsenti, T., Poellhuber, B. et Parent, S. (2020). Le numérique et l'enseignement au temps de la COVID-19, entre défis et perspectives – Partie 2. Apprendre en contexte de pandémie : l'expérience des étudiants et les dispositifs mis en place pour eux par leurs formateurs. Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, 17(3), 1-3. https://doi.org/10.18162/ritpu-2020-v17n3-01
DOI : 10.18162/ritpu-2020-v17n3-01
UNESCO (2019). Recommendation on Open Educational Resources (OER). http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49556&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Wiley, D. (2014). The Access Compromise and the 5th R. Improving learning. https://opencontent.org/blog/archives/3221
[1] Anciennement ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI).
[2] Une version amendée et renommée en septembre 2020 de ce guide est encore en ligne sur le site « Services DGESIP » créé également suite au premier confinement de mars 2020 pour répondre aux questions des établissements : https://services.dgesip.fr/fichiers/Fiche_2_-_Organisation_pedagogique_de_la_rentree_2020__26092020_.pdf.
[3] Nantes Université regroupe une université, trois écoles, deux instituts et un centre hospitalier universitaire (CHU).
[4] Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.
Il y a – déjà – 10 ans, avec Anne-Céline Grolleau, Morgan Magnin, Christine Vaufrey, ouvrions le premier MOOC francophone, ITyPA « Internet Tout y est Pour Apprendre », au moment même où les médias découvraient le phénomène MOOC qui montait depuis début 2012 aux USA.
À l'époque, il y avait deux visions dans les MOOC, celle qui se voulait ouverte, dite collaborative ou connectiviste, un peu sur le modèle de la classe inversée qui est arrivé depuis, et tirer parti du Web comme environnement de collaboration. C'était notre cas, puisque nous voulions au travers de ce MOOC permettre de travailler ensemble sur la manière de travailler dans ce cadre. Un MOOC de démarrage en somme. Le programme s'articulait donc autour de la notion d'Environnement d'Apprentissage Personnel. C'était d'ailleurs la vision initiale des MOOC proposée par George Siemens, Stephen Downes ou Dave Cormier. La vision était celle d'un MOOC comme bien commun.
Les médias et les établissements de l'enseignement supérieur étaient plus intéressés par le storytelling américain proposant d'ouvrir les cours d'universités et plus particulièrement des universités américaines, de toucher le monde entier et d'accueillir les apprenants par centaines de milliers. Dans ce cadre, il s'agissait de transcrire un cours classique avec des vidéos, des quizz, des exercices, un certificat, et un professeur qui passe bien. Moins riche, plus proche des modèles existants, plus facile à suivre, c'est ce modèle qui a été adopté. Et présenté comme une « Révolution ». 10 ans après, les MOOC existent toujours, mais n'ont pas révolutionné l'éducation. Ils ont encore rendu bien des services pendant la période COVID (dite aussi enseignement en situation d'urgence), mais comme un outil parmi d'autres. Ils sont devenus une modalité d'enseignement parmi d'autres. L'ambition d'un enseignement ouvert, collaboratif, voire posé comme bien commun, existe toujours mais reste à la marge du système.
Souvenirs. L'idée de faire un MOOC a été lancée via Twitter au travers de messages en mai 2012, des rencontres rapidement via les premiers systèmes visio, et l'ouverture d'un espace sur Google drive. Le travail se faisait sur le temps libre (Faire un MOOC dans son garage) dans la bonne humeur. Nous avions une impression de facilité. Les personnes que nous sollicitions répondaient rapidement et positivement. Stephen Downes nous a ainsi fait une vidéo et renvoyé le lien quelques heures plus tard. Alors que nous cherchions un système de webinaires permettant de regroupes quelques personnes et de le diffuser en direct, Google sortait son offre gratuite de hangouts qui répondait exactement à ce besoin et que nous avons utilisé intensivement pendant 3 ans. Et surtout, après la première séance du 4 octobre, alors qu'on se demandait comment cela allait se passer (il faut avouer que nous étions un peu stressé ce 4 octobre 2012), on a pu lire les premiers échanges des participants, sentir leur enthousiasme, et les relayer. Enthousiasme, qui s'est maintenu jusque mi décembre, et après puisque certains apprenants ont même créé un espace pour collecter ce qu'il s'était passé pendant ces quelques semaines (voir par exemple le bilan de la saison 2). Et tant de belles rencontres et de discussions passionnantes au cours de ces semaines.
Ce MOOC a connu une seconde saison, durant laquelle Simon Carolan a rejoint l'équipe d'organisation. Puis une troisième saison durant laquelle les 4 initiateurs ont passé le flambeau à une équipe renouvelée d'amis, ce qui de mon point de vue est une des plus belles réussites qu'on puisse imaginer pour un enseignement 
Entre temps, nous sommes passés d'une époque de pionniers qui se connaissaient tous. Je pense à mon collègue Gwendal Simon qui revenant en septembre d'un séjour d'étude en Amérique m'annonçait qu'il se passait un truc extraordinaire aux états-unis, qui a regardé ce qu'on préparait pour ITypa, et qui m'a dit qu'il préférait faire un MOOC classique avec un professeur croisé dans un couloir. Dès février 2013, le premier MOOC sur les réseaux cellulaires démarrait sur une plateforme bricolée, avec des vidéos montées la nuit, Xavier Lagrange en tant que professeur, quelques centaines d'inscrits, et un maximum de satisfaction de la part de Gwendal et Xavier. Rémi Bachelet qui a démarré dès mars 2013 avec son MOOC Gestion de Projet, faisait également partie de mes connaissances.
Après il a fallu de longs mois pour que l'enseignement supérieur s'organise, monte la plateforme FUN (annoncée en octobre 2013), pousse les services pédagogiques a accompagner la création de MOOC, et se pose la question de la finalité de ces cours. Cela nous a pas mal occupé à l'époque, mais pour le coup avec des mandats officiels pour certains d'entre nous.
Et après tout ça. Qu'est ce qui reste dix ans après ? Quels sont les changements de fond dans ces dix dernières années ? Quelles perspectives ?
Et si on se retrouvait en ligne pour en parler ensemble.

Crédit photo : @vainaimoinen https://pxhere.com/fr/photo/1611551 licence CC-0
On a vu récemment les décisions par consentement, mais cela peut prendre du temps. Et s' il y a urgence, on a quelqu'un qui décide pour tous mais cela peut poser des problèmes. Le mieux serait de poser la question à quelqu'un qui doit gérer l'urgence tout en faisant sortir la meilleure décision :

Intervention de Patrick Beauvillard (Institut des Territoires Coopératifs) au séminaire « Plan Biodiversité » du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (14 janvier 2019)
un articlerepris du site de l'institut des territoires coopératifs ; une publication sous licence CC by nc nd
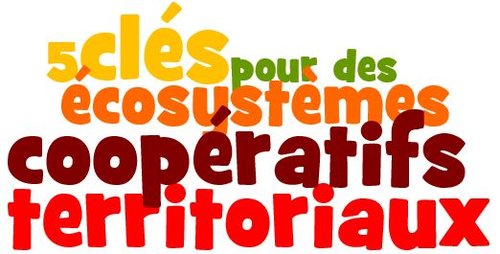
e souhaite démarrer en introduisant la notion de complexité. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe vient du latin « complexus » : ce qui est tissé ensemble. La biodiversité est évidemment une question complexe : les questions écologiques ont des implications économiques, sociales, requestionnent les systèmes de gouvernance, etc.
On ne peut répondre durablement à un problème complexe qu'en associant l'ensemble des parties prenantes dans un processus de coopération. En tant qu'acteurs de la territorialisation du plan biodiversité, il me semble que pour mener votre mission vous devrez contribuer au développement, voire à l'émergence d'un véritable processus de coopération entre les acteurs de votre territoire.
Mon intention est de vous proposer quelques clés pour y parvenir.
Clarifions ce que l'on entend par coopération car on confond souvent des concepts très différents : mutualisation, collaboration ou alliance ne sont pas coopération. Pour définir le mot coopération, je vous propose son étymologie. Co : ensemble – Opera : œuvre. Coopérer c'est être co-auteur d'une œuvre commune. Cette définition pose deux enjeux : comment, à partir d'objectifs et d'intérêts différents voire divergents, faire émerger l'aspiration à une œuvre commune ? Et comment engager les parties prenantes pour qu'elles soient non seulement chacune actrice de sa construction, et qu'elle en devienne co-auteure ?
Vaste sujet qui pourrait facilement occuper 3 jours ensemble… Mais il me reste 7 ou 8 minutes, et je vais vous donner 5 clés pour y parvenir. Certaines vont vous surprendre. Elles peuvent être contre-intuitives, et aller à l'encontre de nos pratiques habituelles. Elles sont issues du travail que nous menons depuis 5 ans : nous les avons identifiées en étudiant la manière de coopérer de plus de 70 collectifs, dans toutes formes et domaines d'activités.
Clé #1 : Le processus coopératif est premier, le projet second.
Un processus coopératif mature est extrêmement puissant. Il permet de déployer les capacités des acteurs bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer à priori. Voilà pourquoi, si votre priorité est de réussir le projet que vous entreprenez, votre devoir est paradoxalement de mettre ce projet en second, et de commencer par construire le processus coopératif qui vous permettra d'y parvenir.
Second ne veut pas dire secondaire : si votre projet est fondé sur la coopération, commençons par développer la « maturité coopérative » du collectif, pour ensuite définir ensemble les objectifs détaillés du projet, ses livrables et son plan d'action. C'est ce que nous faisons en Charentes avec un collectif qui souhaite travailler sur la culture comme levier de développement territorial, ou en région Grand-Est dans le cadre de l'émergence du « Pôle Européen du Chanvre ».
Grandir en maturité coopérative va permettre aux acteurs de dépasser très largement les intentions de départ : 10, 15, 50 co-auteurs seront toujours beaucoup plus performants qu'un chef de projet qui se concentre sur le résultat à atteindre et tente d'animer un collectif espérant que la coopération viendra naturellement. La coopération n'est pas automatique : Investissons pour développer la « coopérativité ».
Clé #2 : Ce ne sont jamais des structurent qui coopèrent, ce sont des personnes.
Et pourtant, visualisez la dernière table de réunion inter-organisations à laquelle vous avez participé : devant chaque personne, il y avait un petit chevalet pour la présenter. Qu'y avait-t-il d'inscrit en gros sur ce chevalet ? Le prénom de la personne ? Son nom ? Sa fonction ? Le nom de sa structure ? Parfois même, on peut lire le nom de la structure sans même que le nom de la personne soit inscrit. Et à la réunion suivante, c'est le même petit chevalet, mais une autre personne est derrière : elle remplace son responsable qui ne peut être présent et se fait représenter…
Cette confusion entre le rôle des acteurs et leur identité empêchent la coopération. Ce ne sont jamais les rôles qui coopèrent. Ce sont les personnes, les personnes physiques. Sans leur engagement il n'y a qu'une coopération de papier entre leurs structures. Pour que cet engagement existe, il est nécessaire que le projet de coopération nourrisse les valeurs et aspirations de ces personnes, et pas seulement les objectifs de leur organisation et de leur rôle dans cette organisation. La coopération est au cœur du processus humain. Elle est essentiellement un processus d'interrelation. Or nos environnements professionnels, et en particulier le monde institutionnel auquel vous appartenez, n'ont pas suffisamment développé la capacité à créer des relations interpersonnelles de qualité. C'est un défi : Apprendre à prendre en compte les personnes.
Clé #3 : Les racines de la coopération sont profondes, et implicites.
J'évoquai à l'instant les aspirations des personnes. Nous avons souvent des difficultés à les exprimer : elles sont là bien sûr, mais le plus souvent gardées au plus profond de soi, voire même non pensées. La troisième clé est d'apprendre à voir ce qui ne se voit pas, à écouter ce qui ne se dit pas, à accéder au sensible.
Nous limitons souvent notre compréhension aux seuls éléments visibles et conscients : on cherche à comprendre un projet, par son contexte, ses objectifs, ses résultats attendus, la cartographie des parties prenantes, les processus de décisions, les outils et moyens déployés… Or, étudier un système humain sous ce seul angle c'est un peu faire comme l'homme qui a perdu ses clés et les cherche sous le réverbère juste parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Ce qui va faire la réussite du projet ne se trouvent pas en surface mais dans des couches profondes, entre les plis : les compétences tacites, les représentations et les croyances, les stratégies cognitives qui orientent les motivations et l'action des acteurs, les habitudes, les automatismes…
Chaque personne a son implicite. Chaque collectif a son implicite. Chaque territoire également. C'est la raison pour laquelle une stratégie qui peut merveilleusement bien fonctionner à un endroit, ne fonctionne pas nécessairement dans un autre territoire. Aucun marin n'imagine partir en mer sans sa carte marine, sur laquelle figurent des repères, invisibles car immergés, mais dont la prise en compte est essentielle pour naviguer en surface. Apprendre à se saisir de cette dimension cachée, non-consciente, implicite est indispensable à l'émergence de systèmes coopératifs. C'est ce que vise l'Observatoire de l'Implicite que nous avons créé.
Clé #4 : Tout prévoir empêchent la coopération ! Sachez laisser du vide.
Je cite Bertrand Piccard : « On dit que la nature a horreur du vide, mais c'est faux. C'est l'être humain qui a horreur du vide, et qui veut à tout prix remplir tous ses doutes par des explications. Nous oublions que l'interrogation est porteuse d'ouverture. » C'est le vide qui permet de créer. Dans un espace où tout est prévu, où chaque journée est prédéfinie du matin au soir, il ne peut pas y avoir de créativité, d'émergence, d'innovation. Quand nos agendas sont trop remplis, ils limitent notre disponibilité à l'autre, et donc à la co-opération. Quand l'ordre du jour de nos réunions est trop chargé : comment voulez-vous avoir une chance d'être co-auteur d'une œuvre commune ? Quand tout est déjà cadré, écrit et défini : comment puis-je mettre mon empreinte puisqu'il n'y a pas d'espace ? Nous menons en ce moment à l'InsTerCoop un projet partenarial, lauréat d'un programme européen pour le développement rural. Nos réunions de gouvernance coopérative sont peu fréquentes (2 ou 3 par an) mais organisées sur deux jours. L'ordre du jour fait 2 lignes : 2 sujets que nous allons explorer ensemble pendant la session.
C'est cet espace créé et laissé vide qui permet aux acteurs de prendre leur place, de devenir co-auteurs et de contribuer à l'effet boule de neige du projet et à son impact grandissant.
Notre peur du vide, l'injonction à aller vite nous fait faire des erreurs préjudiciables. Souvent dans nos réunions, nous passons directement de la phase « problème » et la phase « résolution », sans laisser d'espace de « digestion » entre les deux. Or, nous sommes des êtres organiques : nous avons besoin de digérer les choses qui nous arrivent, besoin d'un espace de « vide » pour permettre de s'approprier la problématique, prendre en compte les éléments implicites dont nous venons de parler, et élaborer une juste réponse. Apprivoiser le vide, ré-introduire des espaces de disponibilité et de digestion est essentiel. Il faut savoir aller lentement pour aller vite.
Clé #5 : Penser en termes de dialogie
Nous courrons après les bonnes pratiques, mais la vraie bonne pratique serait d'apprendre à penser « dialogique ». Prenons un exemple.
Beaucoup de projet démarrent par la recherche d'une « vision et d'objectifs partagés ». C'est évident : nous avons besoin d'unité pour construire des actions communes. Mais cette unité se fait souvent par la recherche d'un plus petit commun dénominateur : si la vision et les objectifs sont réduits à la seule part commune à tous, ils ne sont plus réellement motivant pour personne : on est d'accord, mais on n'agit pas car on a perdu le moteur de l'action.
Cet exemple met en évidence une dialogie entre « unité » et « diversité ». Nous avons besoin de l'unité qui va donner au projet sa puissance, son impact, sa lisibilité. Et nous avons besoin de la diversité qui va donner la vie, la richesse, et permettre d'élargir le cercle des parties prenantes. « Diversité et unité » constituent ce qu'Edgar Morin, le théoricien de la pensée complexe, appelle une dialogie : deux logiques complémentaires, qui peuvent également être concurrentes, voire même antagonistes. A l'InsTerCoop, nous avons ainsi identifié 12 dialogies qui constituent les principes d'action de la coopération et permettent de gagner en maturité coopérative. Penser dialogique permet d'agir en complexité.
Pour conclure, je veux vous dire que la coopération est un levier de résilience et de développement. Les 5 clés que je viens de présenter contribuent à la création de ces écosystèmes territoriaux coopératifs :
- Mettre le processus coopératif en premier
- Prendre en compte les personnes
- Accéder à l'implicite
- Laisser du vide
- Penser dialogique
Wiki-TEDia, la Banque de stratégies de formation par TÉLUQ
Wiki-TEDia est un site collaboratif, évolutif et ouvert consacré à l'approche cognitive de la formation et de l'apprentissage :
- collaboratif, car il bénéficie des contributions des étudiants des programmes en éducation de la Téluq, au moyen de l'écriture collaborative avec un wiki.
- évolutif, car son contenu et sa structure sont progressivement enrichis et révisés, selon l'évolution du domaine des connaissances et des projets éducatifs auquel il participe ;
- ouvert, car tout un chacun peut utiliser pour s'informer sur l'approche cognitive des stratégies de formation réunies dans la Banque de stratégies de formation. De plus, tout étudiant et employé de l'Université TÉLUQ peut y contribuer selon ses connaissances.
Le contenu de la Banque de stratégies de formation a été construit principalement grâce aux contributions des étudiantes et des étudiantes de la TÉLUQ.
L'idée directrice de la Banque de stratégies de formation de Wiki-TEDia est de favoriser le cumul, le partage et la révision continue des connaissances sur les stratégies de formation.
La Banque de cas d'utilisation des stratégies de formation intitulé Wiki-TEDia+ a pour but d'enrichir la Banque des stratégies par une composante de partage de pratiques de design pédagogique.
Le projet Wiki-TEDia vise la production d'un contenu de qualité mais c'est aussi un espace dédié à l'apprentissage. En contribuant, les étudiants et les étudiantes acceptent de soumettre leurs productions au regard externe et à la critique publique. Ils et elles méritent non seulement le respect, mais aussi un guidage bienveillant et constructif qui les aidera à progresser dans leurs apprentissages.
Écrire est une activité intellectuelle exigeante. L'écriture est un outil dont la maîtrise dépend essentiellement de ce qu'on a eu l'occasion de « faire avec ». C'est dans ce sens que l'on peut considérer, en suivant Lev Vygotski (1930-1985), que l'écriture constitue un « instrument psychologique », soit un outil qui permet de réguler et de contrôler l'activité psychique mobilisée dans une situation particulière (Pudelko et Legros, 2000). L'écriture est aussi un outil culturel : on écrit à la fois pour soi, pour les autres, mais aussi avec (ou contre) les autres… en utilisant les conventions, les normes, les indices qui paraissent pertinents dans une situation (Vygotski, 1934/1985 ; Wertsch, 1985).
Écrire est une compétence complexe qui peut être développée par la pratique délibérée. L'intention de Wiki-TEDia est de constituer un espace de pratique délibérée capable d'accueillir l'expression des questionnements et des errements qui l'accompagnent. C'est un espace où tous devraient avoir du plaisir à écrire et, ce faisant, de progresser dans leurs apprentissages (Scardamalia et Bereiter, 2010).
Le contenu de Wiki-TEDia est disponible sous la licence Creative Commons CC- BY SA
un texte repris de la page de présentation
class="modalbox right"
href="https://www.ripostecreativepedagogique.xyz/cache/WikiTediaLaBanqueDeStrategiesDeFormatio_imagebf_image_wikitedia_vignette_600_600_20221005092131_20221005092131.JPG"
title="wikitedia.JPG">

- Enseignant
- Ingénieur ou Conseiller pédagogique
- Formateur
- Responsable de formation
- S'organiser
- Concevoir son cours
- Hybridation des formations
- Co-production, apprendre ensemble
- Ressources pédagogiques
- Ingénierie pédagogique
- Enseigner à distance
- Formation des adultes
- Réutilisation-savoirs ouverts
- Portail d'entrée à un ensemble de ressources
- Outil méthodologique
et / ou
- Institutionnel
- Groupe
Un atelier en visio conférence pour contribuer à une mise en communs de nos expériences, de nos ressources et faire communauté.
Que pourrait être une une plateforme commune de partage de ressources pédagogiques ? quelle gouvernance ? quelle politique éditoriale ?
– lien pour s'inscire à la visio
– lien pour s'inscrire à la liste d'échange
Anthropocene FACTS enjeux socio-environnementaux et transformation des enseignements dans le supérieur
atelier visio le 8 septembre à 17h
un texte de Guillaume Mandil sur Riposte Créative Pédagogique

Cet atelier fait suite à 2 événements organisés par des membres de l'équipe STEEP de l'INRIA. D'une part l'école de printemps Anthropocene FACTS qui s'est tenue à Grenoble du 23 au 27 mai 2022 et d'autre part la conférence Archipel qui s'est déroulée du 20 au 13 juin 2022. Ces événements avaient pour objectifs de contribuer à faire émerger une communauté académique et/ou scientifique autour des questions socio-environnementales. Il est ressorti de ces 2 événements que la transformation des enseignements dans le supérieur était un enjeu partagé par une grande partie des participants.
D'autre part, il est également ressorti de ces évènements qu'il serait utile de partager les multiples expériences dans une communauté afin de ne pas refaire des choses similaires « chacun de son côté ». Pour contribuer à cette mise en commun, cet atelier propose de discuter des contours que pourrait prendre une plateforme commune de partage de ressources pédagogiques (dias, consignes d'ateliers, méthodes d'animation de débats, conférences, etc.).
Afin que cette bibliothèque de ressources soit utile pour participer à la généralisation des transformations pédagogiques dans le supérieur, les discussions qui ont eu lieu au cours de ces 2 évènements ont fait ressortir plusieurs caractéristiques souhaitables pour cette plateforme :
- Mise en place d'une plateforme nationale
- Que les politiques scientifiques et éditoriales soient assumées par une entité juridique indépendante et décidée par la communauté. Via une association ? Une fondation ?
- Gouvernance de la plateforme communautaire, c'est-à-dire par ceux qui contribuent.
- Assurer une forme de relecture critique collective par l'ensemble de la communauté pour rendre les contenus les plus robustes possibles.
- Établir des liens croisés entre les éléments pédagogiques de la plateforme pour apporter des points de vue complémentaires ou critiques.
- Disposer de 2 zones sur la plateforme : une zone « bac à sable » réservée aux contributeurs pour permettre de tester et d'éprouver les contenus au sein de la communauté et une zone publique où sont mis à disposition les éléments « éprouvés ». A partir du moment où un contenu de la zone « bac à sable » est suffisamment éprouvé, il bascule dans la zone « publique ».
L'ensemble de ces caractéristiques sont des éléments qui sont discutables, amendables, et modifiables, ils ne sont mentionnés ici uniquement pour amorcer une discussion. L'idée de mettre en place cette plateforme se veut également être un outil au service de l'animation d'une communauté académique pour favoriser la transformation des enseignements dans le supérieur afin d'y inclure les enjeux socio-environnementaux.
Vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion pour discuter de ce projet à cette adresse : https://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/discutons
Vous invitez vos participants à votre projet. Pourtant au bout d'un moment votre projet s'essouffle. Que se passe-t-il ?